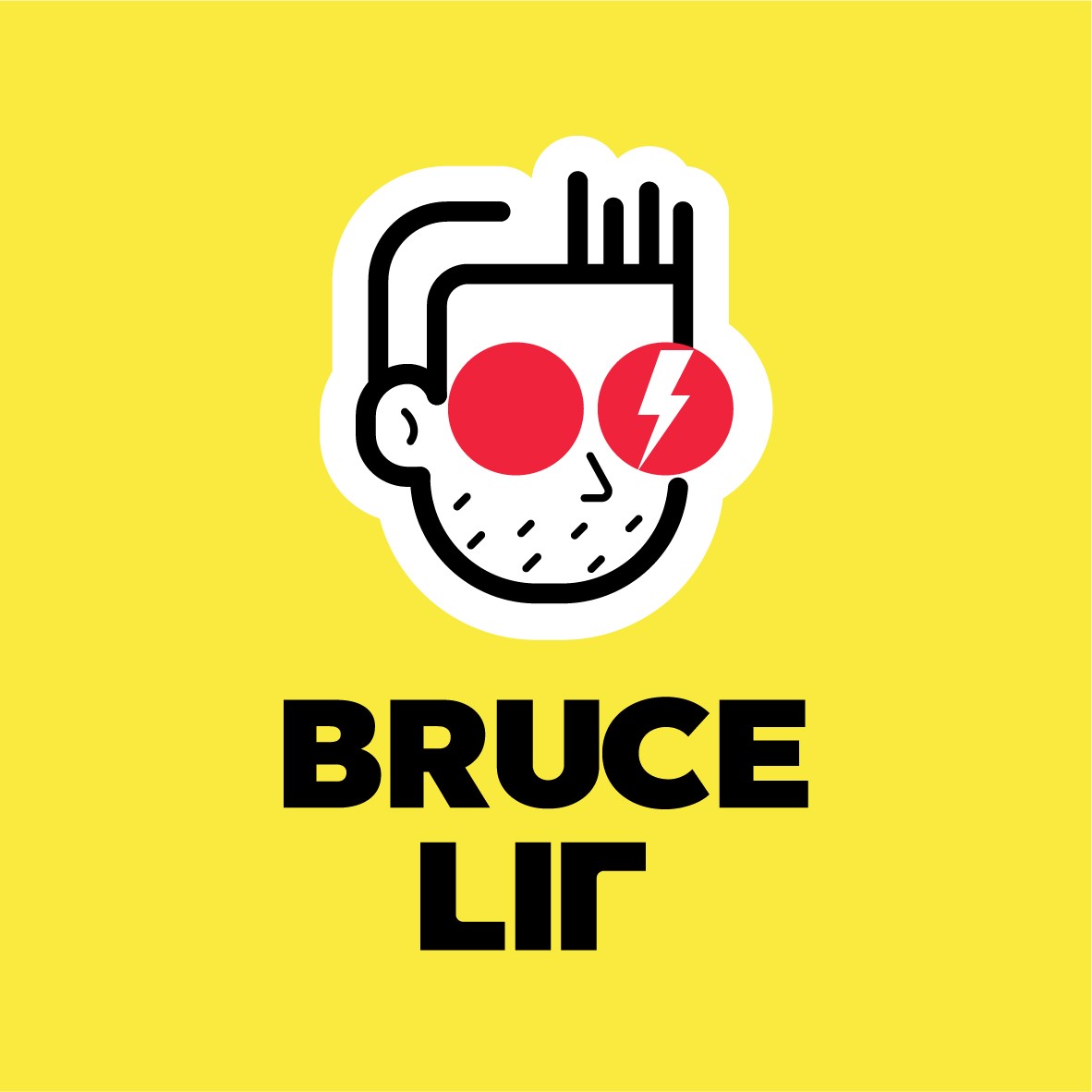IT Follows de David Robert Mitchell
Un article de LUDOVIC SANCHES1ère publication le 27/10/23-MAJ le 17/04/24
Cet article porte sur le film IT FOLLOWS de David Robert Mitchell, il est disponible sur de nombreuses plateformes en VOD et en DVD/BluRay chez Metropolitan. Ce film méritant d’être vu avec le moins d’information possible, je vous avertis, pour ceux qui ne l’aurait pas encore vu, que le texte qui suit contient de nombreux spoilers.

En 2010, sort aux Etats Unis le premier film d’un jeune cinéaste américain David Robert Mitchell, THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER. Bien que présenté en sélection à la Semaine de la Critique à Cannes puis au festival de Deauville où il sera récompensé par le Prix du Jury, le film n’aura pas les honneurs d’une sortie en salles chez nous et n’émergera en DVD qu’après cinq ans d’attente. C’est pourtant l’un des beaux teen movies de ces dernières années. Un film d’autant plus singulier qu’il ne s’y passe presque rien, l’argument dramatique minimal tournant autour d’une soirée pyjama organisée par une bande de jeunes filles, dont les personnages masculins sont exclus. Ces ados, tous campés par une troupe de comédiens débutants, errent lors d’une nuit de fin d’été, le film déployant sur un rythme languide un charme indolent et une douceur cotonneuse qui enrobe ces moments éphémères.
En 2014, son film suivant, IT FOLLOWS aura plus de chance. Présenté à Cannes et primé à nouveau à Deauville puis doublement primé au festival du film fantastique de Gerardmer (il obtient même le Grand Prix), le film finit par se frayer une place dans les salles françaises en 2015. On pourrait dire que c’est en substance le même film que le précédant: une bande d’ados errant dans une banlieue de Detroit (dont David Robert Mitchell est originaire, il est né à Clawson dans le Michigan) tandis que le monde des adultes y est comme laissé hors champ. Pourtant cette fois ci, par le prisme du genre et plus particulièrement des codes du film d’horreur, le récit vient faire peser une menace sur ces personnages, une malédiction que les personnages se transmettent les uns aux autres.
L’ouverture pose d’emblée le décor, celui d’une banlieue résidentielle de la classe moyenne telle que le cinéma américain et le cinéma d’horreur en particulier l’a déjà beaucoup filmé. Soudainement, une jeune fille terrifiée sort de chez elle comme si elle fuyait un danger. Mais au lieu de poursuivre sa fuite vers le monde extérieur qui s’offre à elle, elle revient inexplicablement sur ses pas.
Il faut voir la tension qui se crée entre la vaste perspective offerte par la profondeur de champ et la sensation d’étouffement qui nous gagne: la menace venant moins d’un espace qui serait bouché que du sentiment que c’est le cadre de l’image qui agit comme un étau qui se resserre autour du personnage. D’abord, un léger zoom, puis surtout ce panoramique circulaire qui enferme le personnage dans une boucle dont elle ne semble pas pouvoir sortir. Dans la séquence suivante, le phénomène s’accentue, les plans larges faisant de la jeune fille une petite créature perdue au milieu d’une immensité de l’espace, soulignant paradoxalement qu’il n’y a pas d’issue possible. La menace restant invisible, hors champ, son surgissement se produira lors d’une ellipse, nous n’en verrons que les conséquences, aussi horribles que terrifiantes.

Ce qui saute aux yeux déjà, c’est que clairement David Robert Mitchell connait bien ses classiques. IT FOLLOWS s’inscrivant dans cette veine du cinéma d’horreur qui a conscience de venir après toute une tradition du genre, un héritage partagé autant par le film que par ses spectateurs. D’où ici de nombreuses réminiscences du cinéma de John Carpenter ou de Wes Craven tandis que le climax du film peut être vu comme une relecture de la mythique scène de la piscine de LA FELINE (1942) de Jacques Tourneur. Néanmoins, IT FOLLOWS s’inscrit à contrecourant de beaucoup d’aspect de ce cinéma d’horreur contemporain: une tendance à la distanciation, à l’ironie, à l’humour, la potacherie, redoublée par une esthétique de train fantôme, une surenchère d’effets chocs et un gout pour les films à concepts ou à dispositifs, propres à être facilement déclinés d’un film à l’autre en ces temps où les franchises commerciales sont reines. Rien de tout cela ici.
IT FOLLOWS raconte comment des jeunes gens contractent une forme de malédiction qui se propage suite à un rapport sexuel avec quelqu’un étant sujet à cette malédiction. Le mal se met alors à vous traquer sauf si vous arrivez à le transmettre à quelqu’un d’autre en couchant avec cette personne. Il est intéressant de noter deux reproches qui ont été adressé au film de David Robert Mitchell. D’abord on a reproché au scénario de manquer de cohérence ou d’être trop désinvolte dans sa manière de suivre les règles de la fameuse malédiction. Mais clairement, le film ne se joue pas là (Mitchell revendiquant en interview une « logique onirique » dans la construction de son récit), ce qui le différencie donc de ces films d’horreur reposant sur des concepts et autres dispositifs éventuellement séduisants (une partie de chat version mortelle) mais souvent aussi cache-misères pour des productions médiocres.
Certains ont pris le film de manière littérale, y voyant un propos réactionnaire et moralisateur: le sexe est dangereux, le sexe tue. IT FOLLOWS s’inscrit clairement dans une tradition du cinéma d’horreur pour ados et plus spécifiquement le genre du slasher movie dont on sait qu’il est presque intrinsèquement conservateur: le Mal y est une entité incarnée, seul un personnage pur pourra le détruire, les autres, ceux qui sortent des normes, ceux qui couchent par exemple seront punis. Mais IT FOLLOWS ne raconte jamais cela, il se sert de tous ces codes du genre comme d’une toile de fond de son récit mais pour en faire quelque chose d’infiniment plus riche et complexe. En ce sens, certains ont fait le lien entre IT FOLLOWS et la bande dessinée de Charles Burns, BLACK HOLE (disponible aux éditions DELCOURT), qui racontait l’histoire d’une bande d’ados monstrueux vivant en marge du monde des adultes dans les années 70. Si les deux œuvres sont très différentes, on retrouve cette même appropriation des codes du genre mais dans une œuvre qui ouvre à une bien plus grande multiplicité de ses pistes de lecture.

IT FOLLOWS peut être vu comme un film cinéphile, un méta-film d’horreur postmoderne, mais il l’est de manière plus subtile, plus souterraine que bien d’autres films du même genre. Il est d’ailleurs parfaitement appréhendable au premier degré, et ce avec une efficacité redoutable, atteignant totalement son but premier : captiver, amuser, émouvoir, terrifier. Il faut voir comment IT FOLLOWS se construit par rapport à ses modèles : prenons le plus évident d’entre tous, HALLOWEEN de John Carpenter (1978), dont certains plans du film semblent reproduits presque à l’identique (ces jeunes gens se baladant dans la rue d’un quartier résidentiel, suivis ou précédés par la caméra en de longs travellings ou bien cette scène de salle de classe où l’héroïne voit son attention détournée du cours par l’intuition d’une présence menaçante qui viendrait de l’extérieur).


Rappelons une évidence: Carpenter, comme la plupart des grands cinéastes de films d’horreur, est un cinéaste du hors champ. Le hors champ, c’est ce qui n’est pas dans l’image mais qui pèse sur elle, la conscience d’un danger qui peut y surgir à chaque instant. Mais HALLOWEEN, rappelons le, est plus subtil que cela (contrairement à la quasi totalité des films qui l’ont copié par la suite): il s’agit moins pour le Mal (pourtant incarné par une figure, Michael Myers) de surgir brutalement (ce qu’on appelle le jump scare) que de venir progressivement envahir, contaminer tout l’espace. D’où un autre enjeu important du film, la problématique du regard. Michael Myers, dans le film, est d’abord un regard (par le biais de la caméra subjective), regarder, c’est déjà tuer et donc pour nous spectateur, la mise en scène ne cesse de nous poser la question « qui regarde ? ». Quand nous voyons quelque chose (des jeunes femmes se promenant dans la rue par exemple) c’est moi qui les vois mais n’y a-t-il pas quelque chose qui les observe en même temps que moi, les traque : un tueur, le Mal ?
Dans le cinéma de David Robert Mitchell, la question du regard se pose de manière très directe (elle se posait d’ailleurs déjà des son premier film et ce, rien que par son dispositif narratif, dans THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER, les garçons, étant exclus de la pyjama party des filles, étaient comme des spectateurs d’un récit qui se déroulait sans eux ou dont ils étaient les intrus, les voyeurs). Dans IT FOLLOWS, la mise en scène privilégie des longs plans, parfois avec de légers mouvements d’appareils ou de focale qui mettent en valeur les jeux de regard en jouant sur les échelles de plans. Quand nous découvrons pour la première fois l’héroïne du film, Jay (incarnée par Maika Monroe) elle est vue de l’extérieur de chez elle, dans son jardin, s’apprêtant à se baigner. Il y a la un point de vue un peu voyeur qui laisse percer un sentiment de menace. En fait, le point de vue bascule dans le déroulement de la séquence, une fois qu’elle est entrée dans la piscine, le monde extérieur potentiellement menaçant n’existe plus. Dans l’espace flottant et rassurant de la piscine, elle est en sécurité, nous voyons désormais le monde à travers ses yeux à elle, partageons son sentiment de plénitude.
Ces jeux de regards (qui regarde qui et pourquoi ?) sont essentiels dans la construction des personnages et le récit va en développer diverses variations (voire la séquence où Jay se regarde elle-même dans un miroir avant d’aller à un date avec son petit ami ou le regard du gamin voyeur qui vient espionner Jay par la fenêtre de sa salle de bain). Puis cette mécanique est très explicitement intégrée au récit au début du film par la séquence du rendez vous entre Jay et son petit copain dans une salle de cinéma (comme par hasard). C’est sans doute l’une des séquences clés du film à bien des égards. Jay et son boyfriend du moment font la queue et Jay lui propose un petit jeu: il s’agit pour l’un des deux de choisir secrètement quelqu’un dans la foule autour d’eux avec qui il s’imaginerait bien échanger sa vie. L’autre doit deviner qui son partenaire a bien pu choisir. Le regard et l’observation sont la clé de leur petit jeu. La légèreté de la scène se nimbe soudainement d’une forme de mélancolie quand le petit ami avoue avoir porter son choix sur un petit enfant accompagné par ses parents, avouant une sorte de nostalgie face à l’image d’une forme d’insouciance désormais perdue.
Mais c’est une fois rentré dans l’enceinte du cinéma que le petit jeu se détraque: le petit ami désigne quelqu’un dans la salle mais le plan nous montre bien que, dans les yeux de Jay, il n’y a personne devant eux. Soudain pris d’un malaise, le jeune homme met brutalement fin à la soirée sans que la vraie raison nous soit révélée. Ce n’est que plus tard que nous comprendrons: le jeune homme est possédé par la malédiction et voit les entités qui le traquent. Et son but n’est autre que de la passer à Jay. Et pour cela, il va falloir s’assurer qu’elle n’en soit pas la victime (car si la malédiction tue quelqu’un, elle revient à la personne qui avait contaminé la victime). Pour survivre, Jay va devoir non seulement accepter de voir le danger mais aussi apprendre comment le déceler. Et pour cela, le garçon va l’attacher à un fauteuil et la forcer à voir. Et nous avec elle. Difficile de ne pas faire le lien entre la position de Jay et notre position de spectateur, cloué nous aussi à notre fauteuil et ne pouvant détourner le regard.


Dans les dernières pages de CINEMA 1: L’IMAGE MOUVEMENT (Editions de Minuit), Gilles Deleuze analyse les phénomènes avant-coureurs qui vont faire basculer le cinéma de la période du classicisme à ce qu’il appelle la modernité. Il fait du cinéma d’Alfred Hitchcock un des jalons de ce basculement en prenant pour exemple notamment FENETRE SUR COUR (1954). Il écrit « Et, dans l’histoire du cinéma, Hitchcock apparaît comme celui qui ne conçoit plus la constitution d’un film en fonction de deux termes, le metteur en scène, et le film à faire, mais en fonction de trois : le metteur en scène, le film, et le public qui doit entrer dans le film, ou dont les réactions doivent faire partie intégrante du film » En effet, dans FENETRE SUR COUR, Jeffries, le personnage principal joué par James Stewart, est cloué sur un fauteuil et forcé de fait de regarder ce qui se passe par la fenêtre, l’image que lui renvoie la cour d’immeuble en face de chez lui. Deleuze conclut : « S’il est vrai qu’une des nouveautés d’Hitchcock était d’impliquer le spectateur dans le film, ne fallait-il pas que les personnages eux-mêmes, d’une manière plus ou moins évidente, fussent assimilables à des spectateurs ?«
Des lors, l’idée centrale et tres ingénieuse de IT FOLLOWS, c’est de faire du moteur de la peur moins ce qui est vu que le mécanisme même du regard du spectateur : qui est en train de voir ? quel est ce point de vue ? que dois-je regarder ? Et c’est cela qui rend si efficace la terreur provoquée par le film: la mise en scène organise tout un dispositif qui nous oblige en permanence à scruter les images, à scanner l’espace pour anticiper le danger. Tandis que les jeux de changement de point de vue déploient toute une mécanique de suspense, selon que l’on puisse voir ou pas quelque chose que le personnage lui même a vu ou ne peut pas voir. C’est ce qui explique que IT FOLLOWS fonctionne avec une rare économie de moyens car c’est la mise en scène qui est le carburant de la frayeur que le film provoque.
C’est d’autant plus le cas que David Robert Mitchell fait preuve d’une vraie maestria : l’esthétique du cinéma de John Carpenter y est non seulement convoquée (ce sens du cadre, de la gestion de l’espace, ce gout du vide tendant à l’épure) mais surtout remarquablement assimilée. Le chef opérateur Mike Gioulakis réussit un beau travail, exploitant les potentialités du format Scope et de l’image anamorphique en jouant aussi sur la profondeur de champ, attirant l’attention du spectateur ou au contraire le laissant se perdre dans l’image. Ce sens de l’espace (et aussi la beauté plastique de la photo) permet de surcroit de mettre en valeur le décor et d’en faire un personnage à part entière du film, surtout quand Jay, avec l’aide de ses amis, décidant de remonter la source de la transmission du Mal, sort de son quartier résidentiel rassurant pour s’aventurer dans la banlieue de Détroit, errant dans une véritable « ville fantôme », faite de quartiers abandonnés et d’immeubles en ruines, vestige d’une cité durement touchée par la crise économique et déclarée en faillite en 2013.

Telle une Alice, Jay voir alors surgir sous ses yeux un monde qu’elle ne soupçonnait pas, un monde parallèle, version négative ou cauchemardesque de son monde à elle. Ce monde là, c’est évidemment le monde des adultes, un monde qui, jusque là, leur avait été caché. Si la malédiction trouve un des ses aspects les plus terrifiants dans le fait de s’incarner dans n’importe qui, l’identité des poursuivants est un des éléments les plus mystérieux du film, même si à force de scruter les images, le spectateur attentif sera récompensé par quelques indices. On peut surtout remarquer que dans le déroulement du récit, la nature des incarnations du Mal évolue, passant de figures évoquant la marginalité et l’exclusion à des figures plus familières, des proches des personnages comme les parents pourtant volontairement mis à l’écart du récit.
La fin de l’adolescence, la perte de l’innocence, c’est la révélation comme une possession par le regard d’un monde hanté de spectres, visages de la peur, de la solitude, du dépérissement et de la mort, ces images viennent les hanter comme nous hantent celles du film, elles mêmes hantées par les images qui les ont sans doute inspirées. Cette dimension spectrale suscitant une forme de mélancolie (déjà présente dans THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER) ici venant se teinter d’une profonde terreur et pouvant, face à une profusion d’images et de signes, basculer dans le délire, la folie. Ce sera l’objet du film suivant de David Robert Mitchell : UNDER THE SILVER LAKE.

© It Will Follow INC./Metropolitan Filmexport