DANGEROUS ANIMALS de Sean Byrne (2025)
Un article de LUDOVIC SANCHESEn 1975, JAWS de Steven Spielberg pourrissait les vacances d’été de millions de spectateurs. Un demi-siècle plus tard, après une tripotée de nanars et de copies plus ou moins réussies, Sean Byrne tente de renouveler le genre du « shark movie » et réussit avec DANGEROUS ANIMALS une série B maline qui mêle habilement les registres et en détourne les codes.

© IFC Films/The Jokers
Pendant l’été 1975, un film va traumatiser toute une génération de spectateurs et créer un véritable raz de marée au box office américain, il s’agit évidemment de JAWS de Steven Spielberg, LES DENTS DE LA MER donc qui ne sortira en France que l’année suivante. On connait bien l’histoire aujourd’hui: Bruce, le fameux requin en animatronique, ne fonctionna que rarement sur le plateau lors du tournage, obligeant Spielberg à modifier sa mise en scène et à retarder au maximum l’apparition du monstre à l’écran. Souvenons nous: au début une bande de jeunes font la fête et un garçon et une fille décident d’aller batifoler au bord de la mer. La fille se déshabille et plonge dans l’eau tandis que le garçon reste sur la plage. L’écran large du Scope perd la jeune fille dans la grande étendue de la mer en apparence paisible. Soudain, la caméra plonge sous l’eau et nous montre la fille vue du fond de la mer. C’est à partir de ce moment là que commencent à résonner les fameuses notes de la musique de John Williams. Ce plan là, ce point de vue là, c’est celui du monstre, ce monstre que nous ne verrons pas, mais nous verrons à travers son point de vue à lui, la jeune fille devenue une proie, c’est donc le regard du prédateur.
Dans DANGEROUS ANIMALS, le troisième long métrage du cinéaste australien Sean Byrne sorti cet été 2025 (après une présentation au festival de Cannes dans le cadre de la Quinzaine des Cinéastes), un jeune couple de vacanciers en pleine idylle estivale, décident de se payer un petit frisson en expérimentant une séance de plongée au milieu des requins. Ils embarquent dans le bateau d’un certain Tucker, un marin un peu roublard et mal dégrossi, qui va leur donner ce qu’ils étaient venus chercher. Evidemment, on sait dans quel genre de film on est et on se doute de ce qui va arriver mais tout en s’inscrivant très clairement dans le sous-genre du « film de requin », Sean Byrne choisit de commencer son film sur une épiphanie: selon cette idée que ce qui nous terrifie nous fascine aussi forcément, les deux jeunes tourtereaux, enfermés dans leur cage de protection, apparaissent sincèrement émerveillés de se retrouver sous l’eau au milieu de ces squales qui nagent sans même se soucier d’eux (ce moment trouvera un écho dans une séquence tardive vers la fin du film vécue par l’héroïne face au requin). Il y a une scène assez similaire dans le dernier JURASSIC PARK (JURASSIC WORLD: RENAISSANCE de Gareth Edwards) où un paléontologue fond en larmes une fois arrivé sur l’ile en se retrouvant devant un véritable diplodocus, le monstre du film redevenant un temps l’objet d’un ravissement purement enfantin.

Contrairement à JAWS, Sean Byrne nous donne à voir les requins d’entrée et plein cadre, le regard des personnages se confondant avec notre point de vue de spectateur. Le regard que nous n’aurons jamais, ni dans cette scène d’ouverture ni dans le reste du film par ailleurs, c’est celui du requin, c’est cette caméra au fond de l’eau qui traque les pauvres baigneurs, manière pour Sean Byrne de nous prévenir des le début que le vrai prédateur définitivement n’est pas celui qu’on croit. Ce qui fait le charme de DANGEROUS ANIMALS, c’est de s’inscrire dans le genre du film de requin avec une certaine modestie, il y a un côté « série B » qui passe autant par le traitement assez premier degré de l’intrigue (même si il n’est pas totalement dénué de quelques petites touches d’humour mais ce n’est pas forcément ce qu’il y a de plus réussi) mais surtout un dispositif assez simple et une dramaturgie resserrée: un décor principal (le bateau, la mer autour), trois personnages principaux en gros, les fameux requins et c’est à peu prés tout. Là où le film se révèle vraiment malin, c’est dans sa manière de varier les registres à l’intérieur de cette trame minimale, passant tour à tour par le slasher, le film de tueur en série, le torture porn et le survival de manière à la fois efficace et ludique.
C’est surtout que Sean Byrne va à partir de ces éléments très basiques construire un dispositif bien particulier: en mars 1976, Serge Daney écrit dans LES CAHIERS DU CINEMA une fameuse et très négative critique du JAWS de Spielberg (intitulée MATIERE GRISE) et il explique que la mise en scène de Spielberg « consiste à tout filmer (événements, figurants) de deux – et de deux seuls – points de vue : celui du chasseur et du chassé. Il n’y a pas d’autre point de vue (spatial, moral, politique), pas d’autre place pour la caméra, donc pour le spectateur, que cette double position. » Chez Spielberg, il y a donc la victime et le prédateur, la caméra nous identifiant à l’un comme à l’autre, ce regard du prédateur (le requin relégué hors champ) devenant allégorie du Mal. Chez Sean Byrne, la configuration est plus complexe: il y a les requins certes mais il se sont qu’un élément dans le modus operandi du méchant. Et si le point de vue du requin est absent, c’est parce qu’il y a d’abord celui de la proie, celui du tueur (d’où la filiation avec le slasher movie) mais aussi celui du spectateur qui, par un procédé assez pervers, est incarné par un personnage dans le film, intégré dans le dispositif car il ne suffit pas au méchant de commettre des crimes, il lui faut en plus que quelqu’un puisse être témoin de sa cruauté.

© IFC Films/The Jokers
Dans une tradition des tueurs en série remontant au VOYEUR de Michael Powell (1960), le tueur de DANGEROUS ANIMALS ne se contente pas de tuer, il met en scène ses crimes et les immortalise même avec un vieux caméscope VHS anachronique. Comme dans le slasher movie, la pulsion scopique est indissociable de la pulsion meurtrière (la caméra subjective du tueur dans le HALLOWEEN de Carpenter exemplairement) et JAWS à sa manière anticipe le slasher, surtout en ce qu’il renoue avec une vision monolithique et manichéenne du Mal: tandis que le cinéma d’horreur moderne avait brouillé les repères entre la normalité et la monstruosité (des BODY SNATCHERS aux zombies de Romero), le requin de Spielberg est une figure de l’Altérité absolue qu’il faut détruire (d’où le fait que Daney le rattache au genre du film-catastrophe: « désir d’en finir avec l’horreur, désir de retour à la normale. C’est là la fonction des films catastrophe.« ). Il y a là une forme de puritanisme que le slasher va systématiser (jouir, c’est se condamner à mourir) comme un prolongement de la scène d’ouverture de JAWS et que le tueur de DANGEROUS ANIMALS incarne totalement: il cherche moins à survivre dans un monde qui exige qu’on soit au sommet de la chaine alimentaire (ce que suggère sa mythologie personnelle viriliste quand il raconte à l’envi comment il a survécu à la morsure d’un requin et exhibe ses cicatrices comme le personnage de Quint dans JAWS) qu’à combler l’impossibilité d’un rapport (sexuel) avec l’autre.
Les deux personnages principaux, la surfeuse et le gosse de riche (en plus du fait qu’ils rendent possible une relation entre deux personnes issus de milieux différents), sont les victimes idéales, ils devront être punis. Le garçon semble devoir être là pour réparer la tragédie de la scène d’ouverture du film de Spielberg où le jeune gamin trop bourré s’endormait lamentablement sur la plage tandis que la pauvre fille se faisait dévorer toute crue (et toute une contre culture de l’époque avec, diront certains) par le méchant requin. A l’opposé du « collectif de trouille » (dixit Serge Daney) qui se soude face au requin dans le film de Spielberg, l’héroïne surfeuse de DANGEROUS ANIMALS expérimente une forme de désenchantement, celle de vivre dans un monde où il est impossible d’être totalement libre, il faut faire avec l’autre même quand celui-ci est une potentielle menace (une poignée de main cordiale peut signer votre arrêt de mort) ou qu’il symbolise un monde à jamais inaccessible comme cette ile au loin (sur laquelle des riches estivants font visiblement la fête) sur laquelle on pourrait se réfugier mais qu’on atteindra jamais. Dans la confrontation finale de l’héroïne avec le requin, il n’y a plus de chasseur ni de chassé, la jeune femme réalise que ce qui rend le requin si beau et si terrifiant à la fois, c’est que l’humain le laisse au fond totalement indifférant. Ce qui relie tous ses personnages, c’est leur absolue solitude: la vraie horreur de DANGEROUS ANIMALS, c’est qu’on vit seul et qu’on meurt seul.

© IFC Films/The Jokers
La BO du jour:
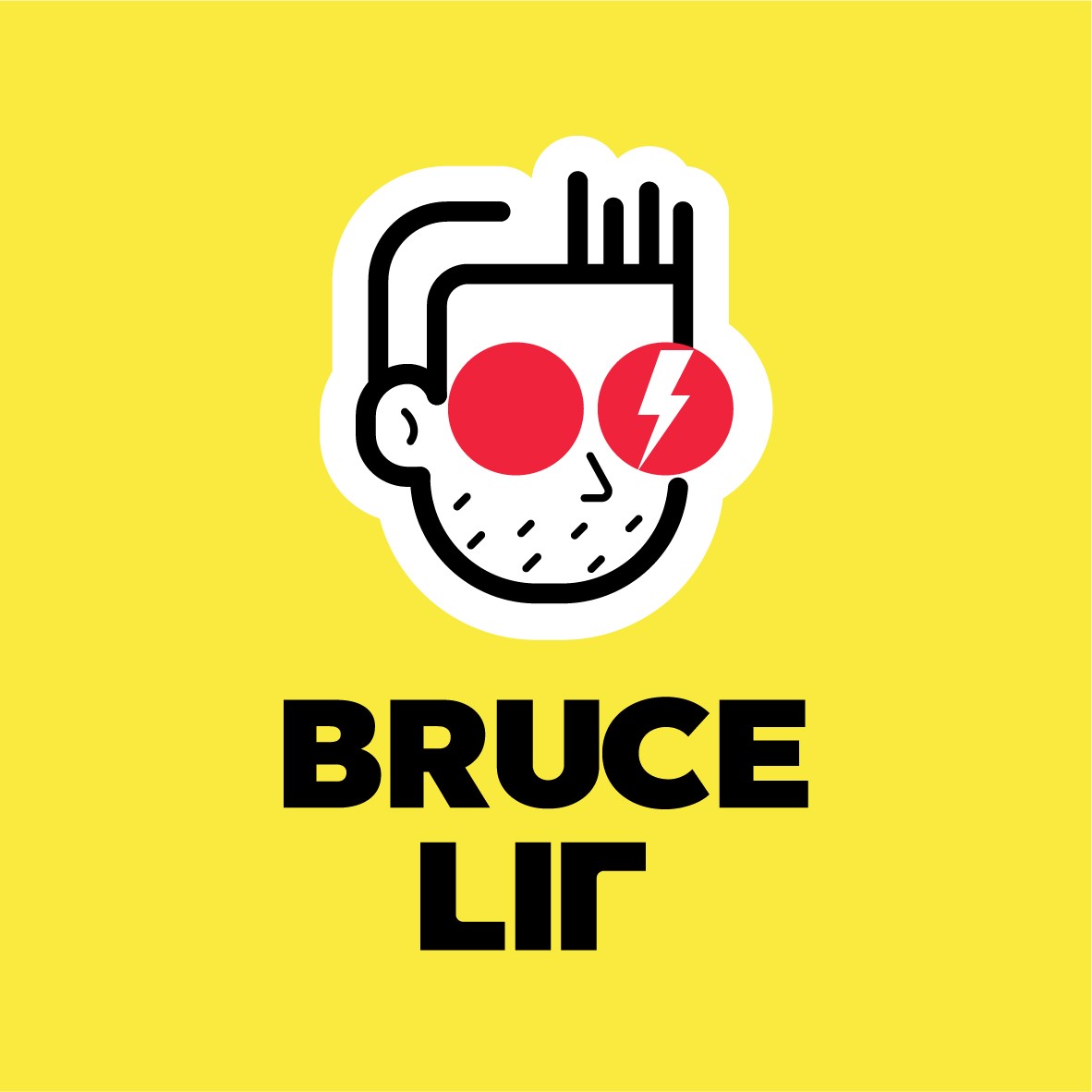
Merci pour cette découverte et analyse.
Je trouve rafraichissant qu’un film n’aborde pas un genre codé sous l’angle du cynisme et de l’ironie, tout en tachant de le renouveler (l’animal reste un danger sans être anthropomorphisé en ennemi intime).
Merci Jb ! je crois que ma sympathie pour cette approche du cinéma de genre est assez évidente, c’est elle qui a tendance à me parler vraiment.
Hello Ludovic,
Je n’ai pas vu le film même si j’en ai eu envie. Avec l’âge, mon appétence pour ce type de films horrifiques a diminué et je m’aperçois que je rechigne de plus en plus à m’infliger la vue de telles images. Ceci dit, ton texte, limpide et lumineux comme d’habitude, me redonne envie de me pencher sur le film.
Est-ce que tu as lu les textes de Samir Ardjoum (Monsieur Microciné sur youtube) à propos du film et de Jaws ? Si ce n’est pas le cas, je t’en conseille la lecture, je les trouve complémentaires au tien. Le texte sur Jaws se situe d’ailleurs dans le sillage (de requin) du texte de Daney que tu cites.
de-marchefilmique.blogspot.com/2025/07/dangerous-animals-sean-byrne-2025.html
de-marchefilmique.blogspot.com/2025/07/les-dents-de-la-mer-ou-le-chef-doeuvre.html?q=spielberg
Bravo encore pour ce très beau texte.
PS : tiens, je réitère la question que j’ai posée il y a quelques jours dans un autre fil et que tu n’as peut-être pas vue : tu as un compte sur letterboxd ?
Merci Zen pour tes remarques et tes commentaires chaleureux ! et oui j’avais lu le texte de Samir sur JAWS et c’est un peu grâce à lui que je suis retombé sur le texte de Daney et à vrai dire, même si le film de Sean Byrne m’avait bien plu, c’est vraiment le fait de prendre l’axe de la comparaison avec JAWS via la critique de Daney qui m’a poussé à écrire ce texte. Du coup, quand il a ensuite sorti son texte sur DANGEROUS ANIMALS, je me suis allé voir me disant que bon, à côté ce que j’avais écrit paraitrait peut etre plus banal. De toute façon, je regarde souvent Microciné et j’ai beaucoup d’intérêt pour ce qu’il fait.
Et pour répondre à ta question subsidiaire: non je n’ai pas de compte Letterbox, une connaissance avec qui je parle souvent cinéma et avec qui j’ai fait des lives me tanne aussi pour que je me crée un compte sur Letterboxd et sur Sens Critique aussi et je sais qu’il faudrait mais je me dis aussi que je vais y passer du temps forcément et je suis tellement obsédé par le fait que j’ai jamais de temps pour (re)voir/(re)lire/écouter tout ce que je voudrai et puis participer à des trucs à droite à gauche et écrire pour le blog de Bruce, c’est déjà très chronophage… bon voila quoi ! donc sans doute un jour je m’y mettrai mais je sais pas quand !
Ah ben, je ne m’étais pas trompé en voyant une complémentarité entre ton texte et ceux de Samir. J’aime aussi beaucoup la chaine microciné et, au-delà de ça, le rapport au cinéma de Samir me parle et me touche beaucoup.
Quand je te lis, je me dis souvent que j’aimerais te voir sur microciné. 😉
Pour letterboxd, ça n’a pas besoin d’être chronophage. On peut très bien s’inscrire sans écrire de critiques. Ca permet de recenser ce que l’on voit et de suivre les visionnages et les notations de personnes que l’on apprécie. Je vois ça avant tout comme un outil ludique et qui peut pousser à la curiosité.
Oui j’ai eu la chance de pouvoir un peu papoter avec Samir en plus et c’était vraiment chouette, c’est quelqu’un de vraiment dispo et passionnant !
Très chouette, cette analyse : ça éclaire précisément les tenants et aboutissants du film, pour ceux qui n’arriveraient pas à se faire une idée précise de l’histoire -malgré l’affiche, quand même assez parlante… Mé bon : je ne suis sûrement pas le seul avec un cerveau un peu lent à la comprenette, hein ?! Merci pour eux, aussi 😉 !
C’est plutôt un point positif, si le réalisateur traite sans fard la réalité de son sujet : ça ne peut que le rendre plus facilement « acceptable », d’un point de vue critique réaliste, par le spectateur. Les excès esthétiques et/ou trop empathiques, propres à des productions horrifiques plutôt basées sur « l’effet » que sur le sens, nuiraient évidemment à l’exposition plausible des dangers inhérents à un animal -et le Grand Schtroumpf sait que les requins en ont trop souvent fait les frais.
Bon, tu mentionnes néanmoins trois catégories de film d’Horreur bien distinctes, que le réalisateur visite avec ce film ; j’ignore donc si l’équilibre entre les nuances est préservé ?
Mais je commente essentiellement parce que l’article est sympa et parlant : complètement réfractaire à toute forme de tension purement survivaliste (et dépourvu du moindre dispositif d’amortissement émotionnel en ce qui concerne les images et/ou les sons !), il y a peu de chances que je visionne ce film un jour -je n’arrive même plus à me faire Jaws, de toutes façons…
Merci Bruno ! ben après j’ai pas voulu trop déflorer l’intrigue non plus, c’est pour ça que je procède par allusion, tout en espérant que mon petit texte reste limpide et lisible et éventuellement donne des pistes au lecteur qui aura ensuite envie de voir le film.
oui je mentionne plusieurs sous genres de l’horreur, je sais pas si il arrive à un équilibre mais en tous cas il les utilisent bien, les termes de genres, de codes voire de clichés peuvent sonner péjorativement mais on peut aussi savoir bien les utiliser pour composer une bonne histoire, il y a une dimension ludique à jouer avec ça, il y a aussi cette dimension dans le film de Sean Byrne, il se débrouille très bien à ce jeu là, tout en faisant un film qui n’est pas dénué de profondeur (ca tombe bien pour un film qui se déroule au large de l’Ocean !).
Je suis carrément d’accord avec ta remarque sur l’utilisation positive des clichés (de genre, de style et même de situation), pour mettre en valeur l’intérêt d’un scénario : c’est un de mes « gimmicks » préférés, quel que soit le médium. Je leurs trouve en général une qualité dynamique qui décuple la puissance narrative via une utilisation intelligente des codes les plus usités. Rien que les personnages stéréotypés qui pullulent dans les fictions qu’on nous propose.
Et, en même temps, dans la vie « réelle », peu de choses échappent aussi aux re-dites.
C’est toujours une aventure analytique de haute volée que de découvrir un nouvel article de Ludovic.
[…] passant tour à tour par le slasher, le film de tueur en série, le torture porn et le survival de manière à la fois efficace et ludique : Houlà ! Quel programme… pas si facile que ça d’associer Ludique et Torture-porn dans une même phrase. 😀
[…] par un procédé assez pervers, est incarné par un personnage dans le film, intégré dans le dispositif car il ne suffit pas au méchant de commettre des crimes, il lui faut en plus que quelqu’un puisse être témoin de sa cruauté. – Houlà ! (bis) Une observation qui donne très envie de savoir quel effet ce procédé a sur le spectateur. Vite la suite de l‘analyse.
Le garçon semble devoir être là pour réparer la tragédie de la scène d’ouverture du film de Spielberg : voilà typiquement le genre de référence qui m’aurait échappé. Pour autant ton article la fait apparaître comme une évidence, le réalisateur Sean Byrne semblant disposer de la culture cinéphilique et de la capacité de mise en abîme nécessaires.
L’humain le laisse au fond totalement indifférant : je suis presque tenté de voir dans le A du dernier mot, une variation sur le concept créé par Jacques Derrida, l’animal restant dans un mode primaire, sans capacité de contextualiser sa proie.
oh c’est trop de compliments, cher camarade (notamment dont la manière dont tu tentes d’interpréter une simple faute de relecture) !
d’ailleurs le « torture porn » n’est pas un sous genre de l’horreur que je goute beaucoup !
et oui Sean Byrne est sans doute conscient de ses références mais son film n’est pas du tout alourdi par ça !
Fantastique analyse qui me donne très envie de découvrir ce film. Une série B qui a quelque chose à dire ça me plaît toujours.
Merci Seb ! j’avais vu le film en salles cet été mais j’imagine qu’il est maintenant visible en VOD !
Il est même déjà sorti en DVD et Blu-ray
Quelle affiche ! Quel article pour finir 2025 !
Merci Ludo
Il faut absolument que je vois ça !
Yes mais comme je disais sur le FB du blog, ce n’est malheureusement pas l’affiche française qui, comme souvent, est beaucoup moins originale !
Très bel article pour un film dont je n’ai pas entendu parler, mais tu le vends bien ! Si je tombe dessus, je vais pas me gêner.
La BO : je ne connais pas du tout, mais cette pop est très sympa. Ca sonne très années 90. C’est dans le film ?
Merci Jyrille !
Non, la chanson n’est pas du tout dans le film, mais je l’aime bien, et ce groupe, enfin un duo de deux frangines originaires de Los Angeles, à l’époque chapeautées par Ariel Pink, de la pop hors du temps, un peu sous acide, elles ont fait deux albums et puis c’est tout, mais j’aimais bien !
Je m’en vais écouter ça alors ! Je ne connais qu’un seul album de Ariel Pink, Pom Pom, mais je l’aime beaucoup.
La BO du film du moins, la tracklist est très très sympa, ambiance surf. Elle apporte beaucoup, et impose une atmosphère cool, parfaite pour contrebalancer les moments les plus sanglants.
« La BO : je ne connais pas du tout, mais cette pop est très sympa. Ca sonne très années 90. C’est dans le film »
J’avais pas écouté le morceau avant maintenant et je trouve aussi que ça sonne très pop early 90’s made in England même si d’après ce que je lis Puro instinct est originaire de Los Angeles.
Ca me fait beaucoup penser, mais quand même en moins bien, aux premiers Lush et aux éphémères mais excellentes Heart Throbs.
Ah oui, voilà, ça sonne très Lush en effet ! Dans le genre, j’aime beaucoup le groupe The Pains of Being Pure at Heart.
en.wikipedia.org/wiki/The_Pains_of_Being_Pure_at_Heart
Hello
j’ai vu ce film ….. et il y a un côté mensonger . Ce n’est pas le digne successeur de JAWS. Oui on vient pour le(s) requin(s) mais comme tu le démontres si bien il n’est finalement qu’un accessoire.
Mais le film est bon. Impressionné par la réalisation et le scénario très malin. J’avais peur de voir un énième slasher de type SCREAM (j’adore le 1 puis le côté méta des suites) avec tout les poncifs du genre. Et bien non. Bien troussé, histoire qui avance intelligemment.
Et surtout un très beau rôle féminin (celui de l’amoureux est également bien écrit et surprenant).
Effectivement tu ne pouvais qu’y trouver un terrain de jeu propice à ton travail sur le regard.
Allez un bémol : légère redondance sur les péripéties de Zephyr. A souligner le choix des chansons.
content que ca t’aies plu, Fletcher !
et oui, tu as raison, la BO est vraiment pas mal !