Encyclopegeek – Stephen King : Adaptations ciné et TV (suite)
Un article de TORNADO
1ère publication le 23/10/18- MAJ le 11/06/23
Cet article est un peu la suite de celui-ci. Dans le précédent, il était alors question de savoir pourquoi l’écrivain Stephen King avait tant été adapté sur les écrans, qu’ils soient grands ou petits.
A présent, nous allons nous contenter de puiser ici et là dans les adaptations cinématographiques et télévisuelles, de manière plus ou moins aléatoire, pour quelques films de plus et un large tour d’horizon s’étalant de 1985 à 2006.
Nous regarderons autant du côté des adaptations fidèles que des infidèles, voire même du côté de certains films vaguement dérivés de l’œuvre du roi de la peur…
1) PEUR BLEUE (1985)
PEUR BLEUE (STEPHEN KING’S SILVER BULLET en VO) est un film réalisé par Daniel Attias. Le scénario est rédigé par Stephen King lui-même d’après son propre roman L’ANNEE DU LOUP-GAROU (CYCLE OF THE WEREWOLF), qu’il avait écrit en 1983.
Le pitch : Dans la petite ville de Tarker’s Mill (dans l’état du Maine), des meurtres abominables sont perpétrés à chaque cycle de la pleine lune. Marty, un jeune garçon handicapé, soupçonne que ces meurtres sont en réalité causés par un véritable loup-garou. Ses déductions vont peu à peu le mettre sur la piste de l’homme qui, la nuit venue, se transforme en loup…
De toutes les adaptations cinématographiques de Stephen King, voila sans doute celle qui souffre de la pire des réputations. Et c’est à cause de cette réputation catastrophique que je n’avais encore jamais regardé ce film jusqu’à hier soir…
Et bien franchement, voilà une petite série B horrifique bien sympathique ! Dans le plus pur esprit des productions de l’époque (le milieu des années 80), le film est un excellent divertissement sans prétentions qui se fond complètement dans le moule des adaptations du King.
Les nostalgiques retrouveront ainsi le charme et l’atmosphère envoûtante qui enrobaient alors tous les films d’épouvante qui, dans la même période, mettaient en scène de jeunes adolescents (STAND BY ME, ÇA, EXPLORERS, GENERATION PERDUE, LES GRIFFES DE LA NUIT, etc.).
Certes, le film est loin d’être un chef d’œuvre impérissable, mais encore une fois il ne mérite pas sa mauvaise réputation (dans le genre, je l’ai largement préféré à LA NUIT DECHIREE, qui bénéficie pourtant d’un meilleur succès d’estime). Bien évidemment, toute la dimension effrayante s’est estompée avec le temps et les apparitions du monstre ne font aujourd’hui plus peur à personne, car la « peur » au cinéma ne fait jamais de vieux os et la portée des expressions horrifiques ne résiste pas au temps qui passe. En revanche, les effets spéciaux sont solides, le casting est très réussi (Gary Busey, Everett McGill et Corey Haim sont formidables), la caractérisation des personnages est particulièrement soignée (et meilleure que dans la plupart des films actuels) et, si l’intrigue en elle-même est complètement basique, voire sans intérêt, l’écriture du scénario et le développement des personnages offrent à eux-seul toute la tenue du film, qui se laisse regarder avec délice, si tant-est qu’on le regarde avec la nostalgie qui va avec…
2) CAT’S EYE (1985)
CAT’S EYE est un film réalisé par Lewis Teague, sur un scénario de Stephen King. Il regroupe trois histoires distinctes, dont deux issues du recueil de nouvelles DANSE MACABRE, la troisième ayant été écrite par l’écrivain lui-même pour le film. Tel un film à sketches, les trois segments sont réunis par un fil conducteur : Un chat errant, qui assiste entant que témoin à des événements horrifiques ou surnaturels…
1° récit : Un homme (James Woods) décide d’arrêter de fumer. Il s’inscrit alors dans une clinique spécialisée. Hélas, les méthodes de la maison sont plutôt horribles avec, à la clé, tortures et mutilation sur les proches de la famille…
2° récit : Un jeune homme (Robert Hays, le héros du film Y A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION !) est capturé par le mari de sa maîtresse, qui n’est autre qu’un gangster local. Ce dernier l’oblige à faire le tour de son building du haut de la corniche, au dernier étage, tout en le tourmentant au fil de son parcours !
3° récit : Une petite fille (Drew Barrymore) recueille le chat errant. La nuit, elle est régulièrement terrorisée par une sorte de lutin démoniaque, qui habite dans le mur de sa chambre. Mais alors que le chat tente de la défendre, les parents, incrédules, pensent que l’animal est un danger pour leur enfant…
L’idée du film à sketches pour mettre en image certaines des nouvelles les plus courtes du King était excellente et, l’on s’en doute, a dû être encouragée par le succès de CREEPSHOW, sorti trois ans plus tôt…
Film d’horreur inspiré des comics TALES FROM THE CRYPT , CREEPSHOW, entièrement écrit par Stephen King et réalisé par George Romero, avait effectivement ramené au goût du jour ce type de format original permettant de diffuser au cinéma de courtes histoires d’épouvante.
La qualité du film de Lewis Teague demeure néanmoins fluctuante, malgré une fiche technique impressionnante réunissant un panel d’artistes haut de gamme. Et si le grand Jack Cardiff assure entant que chef opérateur, garant d’une photographie classieuse, on peine à deviner que la bande-son kitsch et datée a été réalisée par Alan Silvestri !
Au niveau des effets spéciaux, on s’amuse beaucoup avec un lutin aussi rigolo que malsain, créé par Carlo Rambaldi (E.T., KING KONG version 1976).
La mise en scène de Lewis Teague nivèle un peu l’ensemble par le bas, notamment lors du dénouement final (alors que le chat combat le lutin !), assez grotesque et interminable. Un bref aperçu de sa carrière permet de relever que ce réalisateur, habile technicien choisi pour avoir réalisé CUJO deux ans plus tôt, n’a pas fait grand chose de bon (même si, entant que fan de cinéma bis, j’aime beaucoup son INCROYABLE ALLIGATOR !).
La construction du film est également un peu aléatoire puisque les trois récits s’enchainent sans transition, avec un fil conducteur (le chat errant entant que témoin) particulièrement tiré par les cheveux !
Je déconseille, quoiqu’il arrive, de se procurer (allez savoir comment d’ailleurs…) la version française, qui est proprement épouvantable !
En définitive, CAT’S EYE demeure un bon divertissement à l’ancienne, un peu léger, très connoté 80’s, idéal pour les nostalgiques et les fans de la série LES CONTES DE LA CRYPTE , dont il offre un bon contrepoint cinématographique. Entant qu’œuvre signée Stephen King, on reste néanmoins dans les adaptations les moins importantes…
3) LES ENFANTS DE SALEM (1987)
Le pitch : L’anthropologiste Joe Weber, humaniste comme une truelle, retourne à Salem’s Lot, ville de son enfance. Il est accompagné d’un insupportable fils en pleine crise d’adolescence qu’il n’a jamais élevé. Tous deux découvrent que cette petite ville du Maine est désormais peuplée de vampires. Puisque Weber est un modèle d’intégrité (je plaisante), les vampires, rusés comme des chauves-souris, lui demandent d’écrire leur histoire. Dans un premier temps, le placide Weber, qui envoie des bourre-pif à tous ceux qui croisent son chemin, accepte la proposition. Mais il change d’avis lorsque son insupportable gamin lui avoue qu’il a décidé de se joindre à toute cette communauté de joyeuses goules, qui préfèrent par ailleurs vampiriser des vaches endormies que des humains innocents (!). C’est alors que Weber rencontre le chasseur de nazis Van Meer, qui arrive également à Salem et qui, ça tombe bien, n’a pas peur des vampires…
LES ENFANTS DE SALEM (A RETURN TO SALEM’S LOT) est un film réalisé en 1987 par Larry Cohen. Il s’agit de la suite de la mini-série télévisée LES VAMPIRES DE SALEM, qui avait été réalisée par Tobe Hooper en 1979, d’après SALEM, le roman de Stephen King.
Bien que présenté dans les adaptations officielles des œuvres de Stephen King, il ne reprend en rien les lignes d’une quelconque création du King, et ne peut prétendre au titre d’adaptation de manière directe.
Il ne s’agit que de la suite du film de Hooper, et cette suite ne reprend les éléments du roman de Stephen King que comme point de départ.
Stephen King n’est donc nullement responsable de ce fiasco…
https://www.youtube.com/watch?v=3Nn2iZKR1XY
Même le générique, de 42 secondes seulement, est chiant…
Car LES ENFANTS DE SALEM est un navet de première bourre. Une fiente. Un reliquat du cinéma d’horreur 80’s ni fait ni à faire. Et allez savoir pourquoi le réalisateur Samuel Fuller est venu ici jouer les chasseurs de nazis qui chassent les vampires ! Et en plus c’est un film de cinéma, alors que le précédent n’était qu’un téléfilm !
Des nanars, j’en ai vu tant et plus, et j’adore ça. Surtout en ce qui concerne les films fantastiques en général et les films d’horreur en particulier qui, lorsqu’ils sont ratés, ont souvent le mérite d’être drôles. Mais celui-ci n’est même pas drôle. Il n’est d’ailleurs ni effrayant, ni glauque, ni dérangeant, ni beau plastiquement, ni quoique ce soit (les effets spéciaux et autres maquillages horrifiques sont pathétiques). Il est juste nul. Et les incohérences abondent d’une ligne à l’autre de manière ostentatoire. Exemple : Van Meer, miraud comme une taupe, perd ses lunettes et ne peut ainsi plus conduire sa bagnole. Il est alors invité par Weber et ils se font copains pour attaquer les vampires à deux. Immédiatement après, lorsqu’ils partent à l’attaque, Van Meer conduit sa bagnole sans lunettes et sans soucis…
Des personnages têtes à claque, un héros à gerber, des vampires enfants, papis et mamies ridicules, des seconds rôles honteux. Direct poubelle…
Alors ? Y a-t-il encore quelqu’un, dans l’assemblée, qui regrette que cet extrait de film n’ait toujours pas été édité en DVD sous nos latitudes ?
4) LES TOMMYKNOCKERS (1993)
Stephen King écrit son roman LES TOMMYKNOCKERS en 1987. En 1993, un téléfilm en deux parties est mis en chantier par le réalisateur John Power, d’une durée totale de près de trois heures.
Le pitch : Jim Gardner vit dans le Maine, près d’une vieille forêt, avec sa compagne Bobby et leur chien Peter. Bobby est écrivain. Jim est un poète qui n’a plus rien écrit depuis longtemps, et un ancien alcoolique. Il a eu un accident il y a bien des années, qui lui a valu une plaque de métal greffée sur le haut du crâne.
Un beau jour, Bobby se promène dans les bois et trébuche sur un morceau de métal qui dépasse du sol. En essayant de le déterrer, elle s’aperçoit qu’il s’agit du sommet d’une vaste structure inconnue et enfouie depuis des lustres. Rapidement, il s’avère qu’au contact de ce métal mystérieux, Bobby commence à acquérir des facultés incroyables, de même que tous les habitants du village voisin dès que ces derniers pénètrent aussi dans la forêt.
D’abord merveilleux, ces dons deviennent peu à peu une sorte de malédiction, sauf pour Jim, que sa plaque métallique protège de la mystérieuse source de pouvoir…
Outre qu’il plaira certainement aux fans de Stephen King, ce téléfilm comblera également les admirateurs d’une autre adaptation de l’écrivain : ÇA (version 1990). Car pour ceux qui ont grandi et frissonné avec le téléfilm fleuve (et son clown maléfique) réalisé trois ans plus tôt, LES TOMMYKNOCKERS joue les prolongations en reprenant un certain nombre d’éléments formels identiques : Long métrage de trois heures diffusé à l’origine sous la forme d’un téléfilm en deux parties, même genre d’ambiance inquiétante qui évoque parfois celle de TWIN PEAKS, une direction d’acteurs similaire, une musique et des effets spéciaux surannés parfaitement inféodés au style de l’époque, etc. A l’arrivée, le spectateur se retrouve plongé dans une atmosphère très proche de celle de ÇA…
Pour le reste, le récit retransmet parfaitement tous les thèmes que Stephen King recycle constamment dans son œuvre, comme l’enfance et la séparation entre le monde des adultes et celui des enfants, les relations entre la littérature et le réel (l’écrivain donnant corps à ses fictions par le pouvoir de l’écriture), le problème des addictions (Stephen King sortait alors d’une longue et pénible période d’alcoolisme et autres dépendances), le charme vénéneux de la région du Maine, les dissonances au sein de la cellule familiale, la critique sociale par le biais de la vie dans les petites villes, etc.
LES TOMMYKNOCKERS est également une œuvre-somme de son écrivain puisqu’elle entretient de nombreuses liaisons avec d’autres romans (et adaptations), en particulier ÇA et LE BAZAAR DE L’EPOUVANTE (le mal qui s’immisce dans le quotidien d’une bourgade), SIMETIERRE (la forêt comme métaphore de la peur de l’inconnu), DREAMCATCHER, (la science-fiction et les extraterrestres), LES LANGOLIERS (le mal incarné dans un comptine pour enfants), etc.
Mais ce qui reste le plus savoureux dans ce téléfilm, c’est encore cette parabole sous-jacente qui dénonce la fragilité de l’équilibre social américain, où les aspects négatifs de la nature humaine en général sont exacerbés face à la moindre perturbation surnaturelle…
Bref, un excellent divertissement, intelligent et envoûtant, et ce malgré ses aspects kitsch et surannés, qui risquent fortement de rebuter les plus jeunes, étrangers à cette époque télévisuelle, soap et cheap à la fois !
5) LA TEMPETE DU SIECLE (1999)
LA TEMPETE DU SIECLE est une mini-série réalisée par Craig R. Baxley. Initialement diffusée à la télévision en trois épisodes d’environ quatre-vingt minutes (la durée totale est donc de quatre heures et des brouettes), cette histoire est au départ une création de Stephen King. Il ne s’agit pas de l’adaptation de l’un de ses romans, mais bel et bien d’un scénario original, comme ce sera le cas trois ans plus tard, par exemple, avec la mini-série ROSE RED.
Le pitch : L’île de Little Tall est un port insulaire de la région du Maine peuplé de nombreux habitants, qui vivent sous la houlette du maire Robbie Beals, dont le tempérament est tout sauf affable…
Cette communauté paisible s’apprête à subir ce que les informations régionales annoncent comme « la tempête du siècle », qui isolera fatalement l’île du reste du monde durant un certain temps.
C’est lorsque la tempête commence qu’entre en scène le mystérieux André Linoge, un dangereux psychopathe qui assassine une pauvre vieille femme dans sa maison. Linoge ne tarde pas à se faire arrêter par le shérif Mike Anderson. Mais c’est alors qu’il va se révéler plus dangereux encore, car le meurtrier possède un don étrange : Celui de connaître tous les secrets inavouables des habitants de l’île, qu’il n’hésite pas à dénoncer au compte-goutte. Pire encore, il est capable de pousser certains habitants au suicide, voire au meurtre pur et simple. C’est dans le tumulte de la tempête que Linoge va obliger les habitants de Little Tall à faire un choix cornélien, seule et unique condition afin qu’il laisse la communauté en paix…
Parmi tous les thèmes de prédilection du King, c’est bien évidemment celui de la critique sociale par le biais de la vie dans les petites villes qui est au cœur de LA TEMPETE DU SIECLE. L’auteur développe ainsi une parabole sous-jacente qui dénonce la fragilité de l’équilibre social américain, où la moindre perturbation surnaturelle va venir exacerber les aspects négatifs de la nature humaine.
Le film a déjà énormément vieilli dans sa mise en forme et les effets spéciaux accusent le poids de l’âge. Mais le scénario est plutôt brillant et le dénouement, sans concessions, est un véritable coup dans le cœur, qui ne laissera aucun spectateur indemne.
Du grand Stephen King, riche, intense, profond, qui mériterait une adaptation définitive sur grand écran. Cependant, on ne saurait oublier cette première version et l’interprétation habitée de Colm Feore, qui incarne un démon assez fascinant…
6) DREAMCATCHER, L’ATTRAPE-REVES (2003)
DREAMCATCHER, L’ATTRAPE-REVES est tout autant un film d’horreur que de science fiction. Film à grand spectacle aux effets spéciaux impeccables, interprété par des acteurs de premier plan (à commencer par Morgan Freeman) et réalisé par un grand nom d’Hollywood (Kasdan est aussi bien le scénariste de certains STAR WARS que des AVENTURIERS DE L’ARCHE PERDUE, de LA FIEVRE AU CORPS, SILVERADO ou encore WYATT EARP), le film fait néanmoins partie des adaptations de l’œuvre de Stephen King parmi les plus mal aimées, même s’il possède tout de même quelques défenseurs.
Le pitch : Quatre amis d’enfance trentenaires partent chaque année pour une partie de chasse dans les forêts du Maine, via une vieille cabane isolée comme point de ralliement, à l’intérieur de laquelle trône un énorme attrape-rêve indien. Ils sont reliés par un mystérieux lien télépathique apparu depuis qu’ils sont venus en aide, il y a bien des années, au jeune Duddits, un handicapé aux étranges pouvoirs devenu ensuite leur ami.
Dans le blizzard de l’épaisse forêt, nos compagnons rencontrent bientôt deux personnes atteintes d’un étrange mal. Un mal bien plus horrible qu’ils ne s’y attendaient, puisqu’elles hébergent chacune dans leur estomac une belliqueuse créature extraterrestre…
Une course contre la survie commence alors, tandis que l’armée tente d’étouffer l’affaire tout en contenant l’invasion alien, sous le commandement du redoutable Colonel Abraham Curtis…
Quel ovni, c’est le cas de le dire !
Ce film est assez insaisissable. Tour à tour brillant et médiocre, superbement écrit et bourré de fautes de script, il s’inscrit dans le palmarès des œuvres bancales aussi attachantes que ratées !
C’est cette étrange cohabitation des deux extrêmes qui va traverser les 136 minutes de DREAMCATCHER, L’ATTRAPE-REVES du début à la fin. Que ce soit dans l’écriture du scénario, dans la mise en scène, dans les dialogues ou dans la direction d’acteurs, Lawrence Kasdan zigzague systématiquement entre la maîtrise de son sujet et la bérézina artistique !
Hésitant sans cesse entre le tragique et la parodie, le brillant scénariste de la saga STAR WARS s’empêtre dans une narration bicéphale où le ton burlesque est constamment à côté de la plaque, venant contredire le sujet tout en désamorçant la moindre scène d’angoisse.
https://www.youtube.com/watch?v=vZPtLIQJAi8
L’autre gros point noir de l’entreprise réside dans le fait que le final est particulièrement raté et, allez savoir pourquoi, s’oppose tout simplement à celui du roman originel.
Certes, en adaptant l’œuvre de Stephen King, Kasdan avait le bénéfice de la relecture et pouvait honorablement en réinterpréter la fin. Sauf qu’il nous propose une conclusion particulièrement contradictoire, n’apportant aucune résolution au cheminement thématique des personnages et annihilant au contraire la portée du récit de l’écrivain. Le lien télépathique qui lie les personnages n’a dès lors plus aucun sens, le personnage central (le mystérieux Duddits) se retrouve totalement dénaturé et, au final, le thème de l’attrape-rêves est complètement passé aux oubliettes !
Conçu comme un récit plus ou moins connecté avec l’histoire développée dans ÇA (l’histoire se déroule au départ dans la même ville fictive de Derry et il est fait référence au Club des Sept Paumés), DREAMCATCHER développait en filigrane certains des thèmes récurrents du King.
Certes ponctué de notes d’humour, le roman était un condensé de récits science-fictionnels fondateurs (LA GUERRE DES MONDES, ALIEN ,THE THING et X-FILES) qui, comme un effet de boucle (la plupart des écrits de Stephen King ayant été adaptés sur un écran), venaient essentiellement des médiums télévisuels et cinématographiques !
Mais surtout, DREAMCATCHER était un prolongement naturel de ÇA : En faisant de son quatuor de personnages (ou quintet si l’on ajoute Duddits) un groupe d’adultes tourmentés, n’ayant jamais réellement réussi à s’adapter à la vie sociale à cause de leur pouvoir télépathique, Stephen King nous parlait de la difficulté de grandir. Tous réunis rituellement autour d’un énorme attrape-rêves, ses héros marquaient ainsi cette parabole du difficile passage à l’âge adulte, thème central de l’œuvre de l’écrivain. Et en combattant des extraterrestres, ils s’inscrivaient à la fois dans la tragédie de la vie et dans le monde de l’enfance. Un monde symbolisé par Duddits, attrape-rêve vivant (est-il devenu malade à force d’absorber leur mal-être ?) vers lequel ils devront se tourner pour survivre, ou pas…
A l’arrivée, Lawrence Kasdan se sera cassé les dents sur le terrain de l’adaptation en essayant d’être parfois trop fidèle (une tonalité humoristique qui ne fonctionne manifestement que dans les lignes et dans le style de l’écrivain), tout en proposant une fin différente complètement en décalage avec le récit initial et sa portée parabolique…
7) LE JOURNAL D’ELLEN RIMBAUER (2003)
Stephen King ? Et bien non, l’écrivain n’est pas à la plume ici, ni au niveau du scénario, ni au niveau du roman initial (LE JOURNAL D’ELLEN RIMBAUER : MA VIE A ROSE RED), ni même au niveau du script. LE JOURNAL D’ELLEN RIMBAUER n’est donc pas « un Stephen King » et ce n’est pas l’adaptation de l’un de ses romans.
Ce téléfilm a été réalisé par Craig R. Baxley et a été écrit par Ridley Pearson, d’après son propre roman. Alors pourquoi diantre en parle-t-on dans un article dédié aux adaptations de Stephen King ?
En 2002, le King rédige le scénario d’une mini-série télévisée : ROSE RED.
S’inspirant du film LA MAISON DU DIABLE, Il reprend alors le décor d’une soi-disant véritable maison hantée (la mystérieuse Maison Winchester).
Comme à son habitude, l’écrivain parvient à injecter une toile de fond pleine de sens en imaginant cette maison construite avec des pierres du vieux continent transportées dans le Nouveau Monde, dont la mise en chantier est initiée par un homme mauvais, qui épouse une femme qu’il va peu à peu souiller de ses déviances (souvent sexuelles). Eprise de sa maison davantage que de son mari, la jeune femme va tisser des liens malsains avec la demeure, qui développera de manière vengeresse et ostentatoire toutes ses malveillances inconscientes (soit un thème déjà abordé de manière plus ou moins proche dans SHINNING)…
Ensuite, King va jouer sur les poncifs du genre en préparant une campagne publicitaire basée sur le fameux postulat « inspiré d’une histoire vraie », qui est devenu l’apanage des films de maison hantée (on se souvient d’AMYTIVILLE LA MAISON DU DIABLE dont certains pensent encore qu’il s’agissait quasiment d’un documentaire !). Il laisse alors finement entendre qu’il existe quelque part « le journal intime d’Ellen Rimbauer », la jeune femme qui habita le manoir Rose Red, dans lequel de nombreuses personnes disparurent de manière mystérieuse, et qui est devenue sa principale source d’inspiration…
Par delà les réseaux sociaux, la rumeur se répand et Rose Red devient ainsi la nouvelle maison hantée sur laquelle il faut compter ! La production demande alors à l’écrivain Ridley Pearson d’entamer la rédaction du roman LE JOURNAL D’ELLEN RIMBAUER : MA VIE A ROSE RED, qui narre la genèse de ROSE RED et dont l’adaptation télévisuelle sera tournée en 2003. Voilà pour l’histoire !
Cette préquelle est par ailleurs très réussie. La reconstitution dans les décors du début du XXe siècle à Seatle est de toute beauté et la mise en scène est à la fois sobre et raffinée. Le quotidien de l’aristocratie des années 1900 est également très bien rendu et le spectateur découvre de l’intérieur le passé de ROSE RED qui avait été évoqué dans la mini-série de 2002.
Afin de développer une véritable continuité visuelle, certains acteurs du téléfilm originel ont été réemployés (notamment Tsidii Le Loka, qui interprète Sukeena, la domestique africaine et confidente de la jeune Ellen) et plusieurs événements à peine effleurés dans ROSE RED sont entièrement dévoilés, avec parfois quelques surprises.
Le classicisme de la mise en forme ne destine pas le film à sortir des sentiers battus, mais ce dernier offre en tout cas un très bon complément à la mini-série écrite par Stephen King…
8) RIDING THE BULLET (2004)
RIDING THE BULLET est un film réalisé par Mick Garris. Il s’agit de l’adaptation de la nouvelle UN TOUR SUR LE BOLID’, écrite par Stephen King en 2000.
Mick Garris s’est fait le spécialiste des adaptations de l’écrivain, puisque il a également réalisé LA NUIT DECHIREE (1992), LE FLEAU (1994), SHINNING (1997), DESOLATION (2006) et BAG OF BONES (2011).
Le pitch : 1969. Le jeune Alan Parker, en proie à des hallucinations fréquentes, apprend que sa mère, victime d’une attaque cardiaque, vient d’être hospitalisée. Il traverse alors le Maine en autostop, afin de rejoindre Lewiston, sa ville natale. Son parcours, le temps d’une nuit particulièrement effrayante, ne sera pas de tout repos. Surtout lorsqu’il monte dans la voiture d’un certain George Staub (David Arquette), un homme mort depuis deux ans qui lui parle du « Bolid' », le manège d’un parc d’attraction ayant traumatisé Alan lorsqu’il était petit…
J’ai hésité longtemps avant de regarder ce film car, comme tant d’autres adaptations des écrits de Stephen King, il souffre de critiques très défavorables. Une fois encore, je n’aurais pas dû me fier à la tendance car le film en lui-même est plutôt envoûtant et se laisse regarder avec grand plaisir.
Envoûtant grâce à cette atmosphère magique de l’état du Maine, dans lequel se déroulent la plupart des récits imaginés par le King. Grâce à toutes ces scènes nocturnes oniriques, plus impressionnistes que narratives, qui semblent nous inviter à une sorte de cauchemar éthéré et fascinant.
Addictif car, comme toujours, une histoire de Stephen King, c’est la promesse de découvrir des personnages solidement campés, au caractère fouillé, échappant au manichéisme primaire en devenant attachants grâce à un sens du détail inné et savoureux.
Passionnant puisque, à chaque fois, l’on retrouve une toile de fond développant les thèmes récurrents du maitre de la peur. RIDING THE BULLET explore ainsi le glissement entre le monde des morts et celui des vivants, tout en évoquant la difficulté de passer du monde de l’enfance à celui des adultes, soit deux des principaux thèmes du King, ici réunis comme si l’un nourrissait l’autre. Stephen King a d’ailleurs imaginé cette histoire au moment où sa mère était tombée malade et il tentait ainsi d’exorciser sa peur de la perte d’un être cher par une réflexion profonde sur la mort, teintée de nostalgie et de réminiscences biographiques.
Pour le reste, Mick Garris a ponctué le film d’apparitions fantomatiques en tout genre qui ne font pas toujours sens et qui viennent alourdir le récit en lui procurant une dimension Grand-Guignol dont il aurait effectivement pu se passer. RIDING THE BULLET n’est donc pas un chef d’œuvre, mais il ne mérite pas sa mauvaise réputation de par sa très belle toile de fond et son atmosphère soignée et envoûtante.
9) DESOLATION (2006)
DESOLATION (DESPERATION en VO) est un téléfilm réalisé par Mick Garris. Il s’agit de l’adaptation du roman homonyme de Stephen King, ce dernier ayant par ailleurs écrit et produit le long métrage.
Le pitch : Sur une route déserte du Nevada (pléonasme), un jeune couple est arrêté par un shérif à l’attitude très inquiétante, qui le conduit à Désolation, une petite ville désaffectée et sordide. Là, le shérif enferme toutes les personnes qui passent dans le coin, en leur faisant subir diverses maltraitances, le plus souvent de façon meurtrière…
Comme d’habitude, cette adaptation est loin de faire l’unanimité du fait de sa fidélité relative au roman originel. Pour le coup, sachant que le téléfilm a été écrit par Stephen King en personne, la critique est parfaitement stérile, l’écrivain ayant décidé lui-même de toutes les modifications, profitant du changement de medium afin de livrer une forme de relecture. C’est-à-dire la même histoire, mais racontée de manière différente, avec diverses transformations.
N’ayant pas lu le livre, j’ai donc découvert le film pour ce qu’il est : Un assez bon téléfilm horrifique, assez terrifiant, au suspense impressionnant.
Il est vrai que l’ensemble bénéficie de l’écriture du maître, qui n’a pas son pareil lorsqu’il s’agit de développer le caractère de ses personnages, toujours bien campés, soulignés par un vibrant sens du détail. Ainsi que du casting haut de gamme, avec la présence incomparable de Ron Perlman dans le rôle de l’affreux shérif, de Tom Skeritt dans celui de l’écrivain arrogant, de Steven Weber (qui interprétait Jack Torrance dans le remake de SHINNING) et d’Annabeth Gish (la Monica Reyes de la série X-FILES).
Comme de coutume, nous retrouvons certaines des principales thématiques du King, dont celle de la ville consumée par les liens malsains tissés entre les habitants et les lieux (ici une ancienne ville minière dont les contribuables se sont enrichis en ayant réduit les travailleurs chinois en esclavage), thème déjà présent dans LES VAMPIRES DE SALEM, LE BAZAAR DE L’EPOUVANTE ou encore LES TOMMYKNOCKERS ; le thème de l’enfance et du difficile passage à l’âge adulte (ÇA ou STAND BY ME) ; le problème des addictions (notamment l’alcool) ; et enfin celui de l’écrivain en quête de rédemption et qui cesse d’écrire, sortant du confort de l’imaginaire afin de lutter contre le mal de manière concrète.
Concernant la qualité du film en lui-même, notons un fléchissement dans la seconde moitié de ses 125 minutes, lorsque les personnages ne cessent d’avancer leur foi en Dieu afin de combattre le mal. Une foi bigote qui va peu à peu contaminer tous les protagonistes, y compris les plus réfractaires. Soit un manichéisme plutôt primaire auquel le King ne nous avait pas habitué. C’est ce dernier élément qui vient alourdir et un peu gâcher l’ensemble.
La dernière partie du film est ainsi un peu décevante. Car si l’ensemble commençait comme une histoire d’horreur moderne originale, terrifiante et malsaine, le film se termine comme une fable béate et classique de la lutte entre le bien et le mal…
Ainsi se termine notre tour d’horizon non exhaustif, dans lequel il manque évidemment une palanquée d’adaptations, certaines probablement plus emblématiques que celles qui viennent d’être chroniquées (comme la mini-série LE FLEAU par exemple, ou la récente série anthologique CASTLE ROCK). Mais si vous êtes sages, on reviendra peut-être vous en causer…
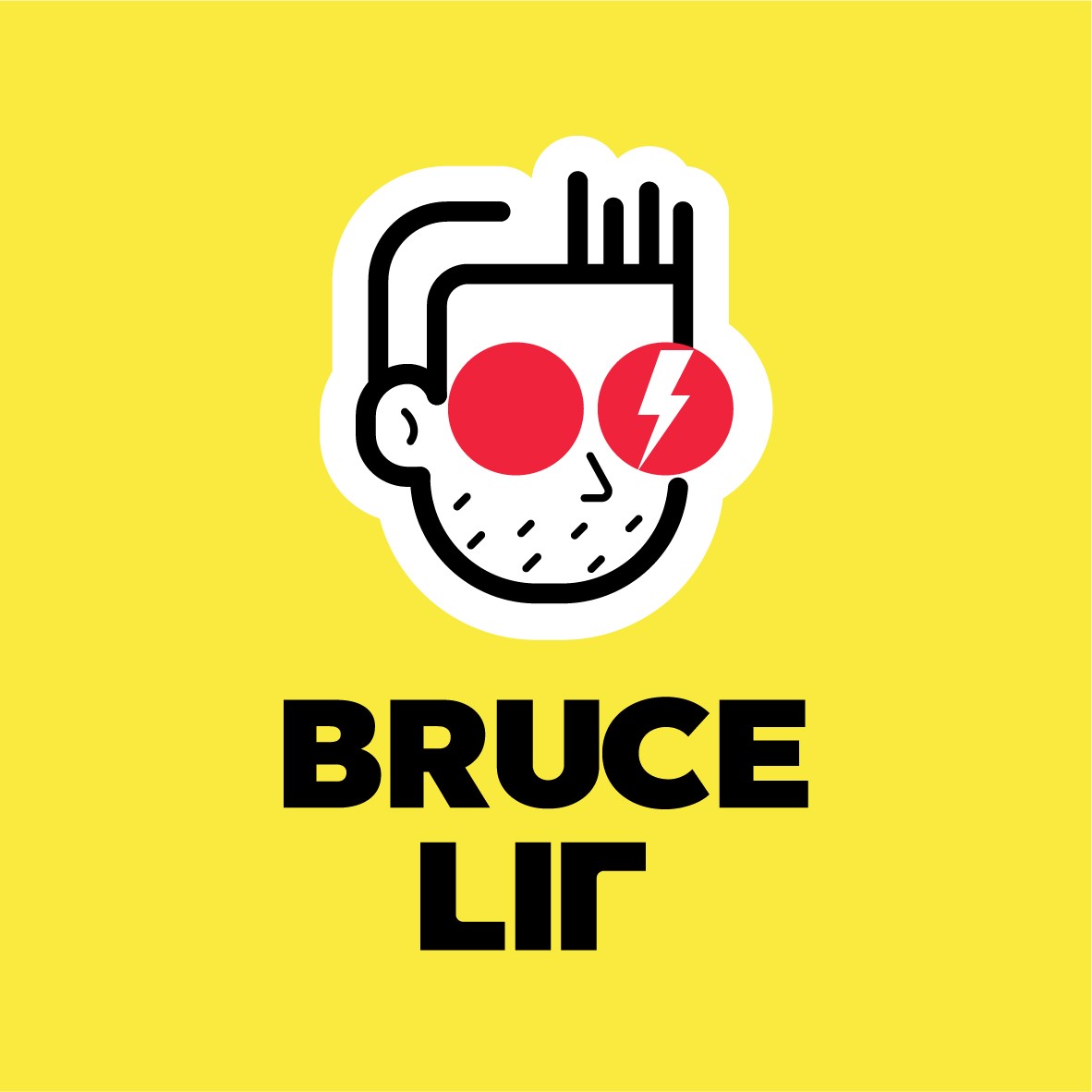
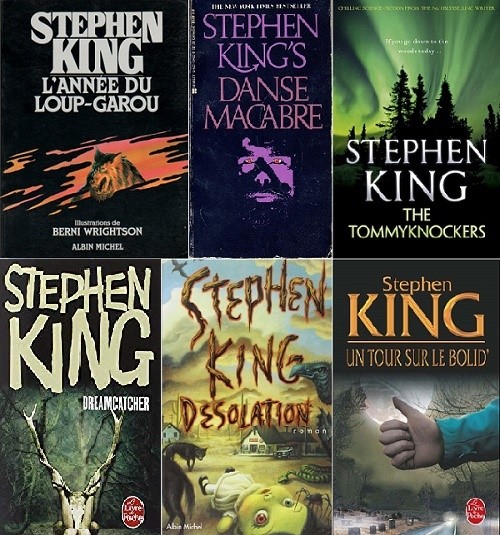
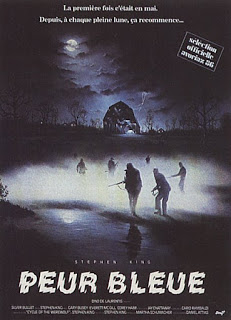
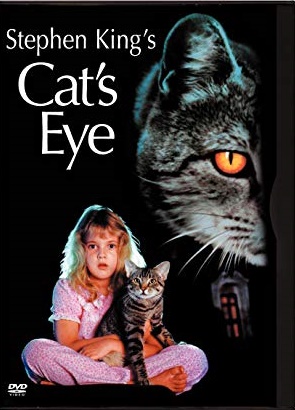
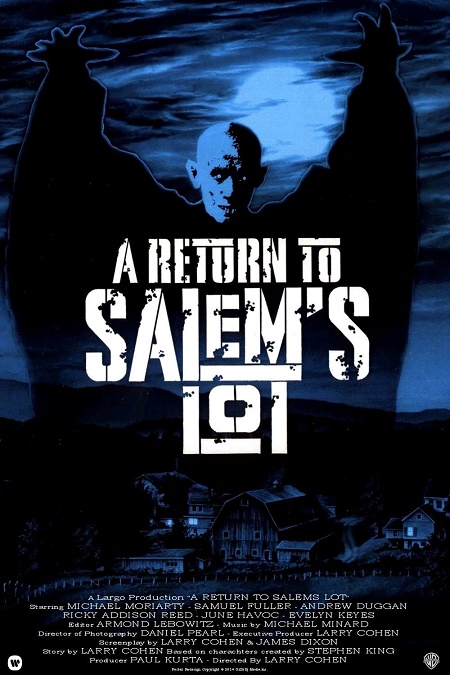
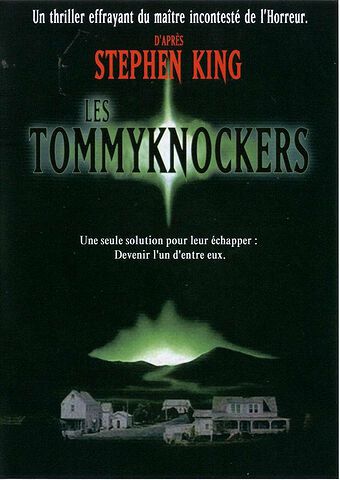
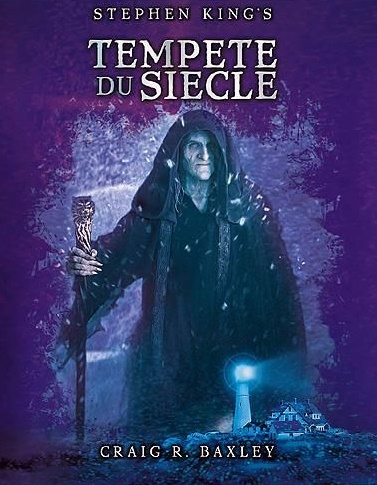
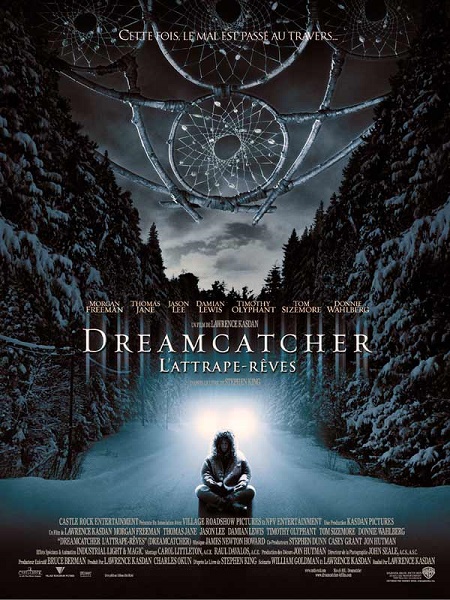
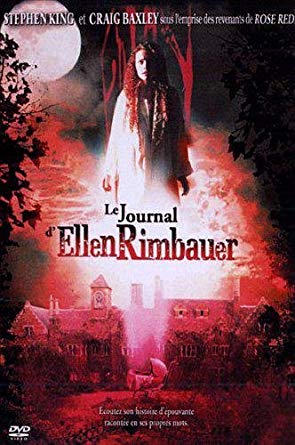
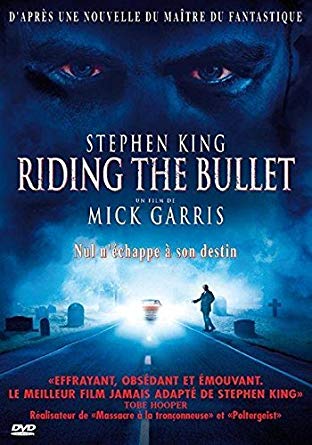
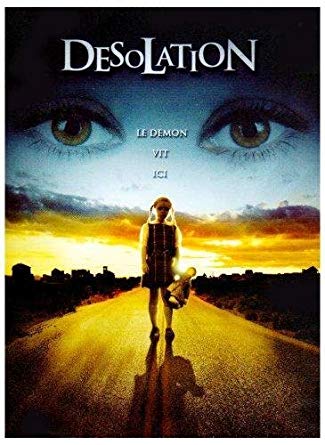
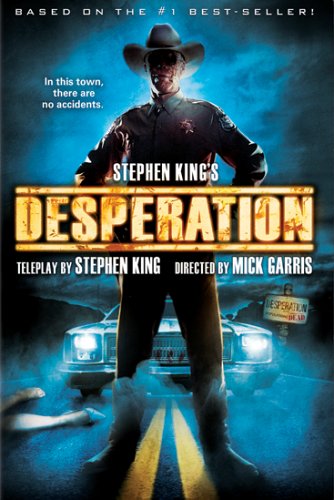
Dès que ma femme a le dos tourné, je profite de voir de « vieux » films qu’elle ne supporterait pas. C’est ainsi que j’ai hésité entre Mutant Aquatique et Peur Bleue que j’ai adoré. Je partage complétement ton analyse, Torando. Je ne comprends pas que le film se soit fait descendre.
Wow, y en a plein que je connais pas (bon, visiblement, les enfants de Salem, j’ai pas de regrets à avoir)
Je pourrais faire encore d’autres articles comme ça. Des suites. Y a plein d’autres films (voire des séries) à chroniquer encore.
Je viens de voir LE CROQUE-MITAINE et je ne savais pas que c’était d’après une nouvelle de Stephen King. Je ne sais pas dans quel recueil il peut être. Le film est pas terrible mais pas nul non plus, on voit un peu les prémices de CA.
C’est dans DANSE MACABRE. Le recueil le plus emblématique du King.
C’est fou. C’est un super article, super documenté, bien argumenté et pourtant que je fuis car chaque fois que j’ai lu du Stephen King j’ai été plus que déçu (un des rares écrivains reconnus dont le style ne me convient pas du tout, du tout, du tout).
Presque pareil côté adaptation même si là je m’y retrouve plus, surtout pour le côté cinématographique (CARRIE, LA LIGNE VERTE, SHINING et vive vive Kubrick d’avoir « trahi », LES EVADES, DEAD ZONE, STAND BY ME, MISERY).
Pour ce qui est du style, il convient aussi de dire que King n’a pas toujours été très bien servi au niveau des traductions.
Je me permets de dire ça après en avoir lu aussi bien en français qu’en anglais.
La principale force de King, ce n’est pas tellement le fantastique, qui au fond n’est pas très original et reprend inlassablement les quelques mêmes tropes, c’est la manière dont il fait surgir le fantastique à partir du naturalisme.
King a une capacité à animer ses personnages qui est, dans ses meilleures productions, vraiment exceptionnelle. Et ça fonctionne parce qu’il a également une capacité exceptionnelle à les planter dans un environnement où tout sonne juste.
Il y a une justesse et une acuité dans le regard qu’il pose sur ses personnages et l’environnement dans lequel ils évoluent qui le placent très largement au-dessus du tout venant que l’on rencontre dans la littérature dite fantastique.
Je m’étonne un peu qu’en tant que fan de Springsteen par exemple, tu ne sois pas sensible à ces qualités.
Sinon, le Shining de Kubrick, c’est précisément sur ces points qu’il trahit le plus le Shining version King.
Perso, je ne suis pas fan du film de Kubrick.
Tiens, je suis assez d’accord avec Zen (sauf que je suis quand même fan du Kubrick). Comme dit dans l’article, son écriture des personnages, leur caractérisation est à chaque fois exceptionnelle. Après son écriture formelle est parfois clivante, c’est vrai. Je ne suis pas arrivé au-delà du 2° tome de la TOUR SOMBRE par exemple. Même si je sais que j’essaierai un jour de m’y remettre.
En tout cas, je trouve et je persiste à penser qu’il reste un auteur majeur du 20ème siècle avec ses thèmes récurents, totalement dans le moule de son époque (également développés (humblements) dans mes deux articles).
Je pense également que Stephen King est un auteur majeur de ces 50 dernières années et que son activité au sein d’un genre trop souvent traité avec dédain ne doit pas l’occulter.
Et en plus, son influence sur la pop culture de notre époque est incommensurable.
Par ailleurs, j’ai profité de cette remise à l’honneur pour lire ton premier article sur les adaptations de King et j’ai trouvé ton analyse des thèmes majeurs du King d’une très grande pertinence et d’une limpidité sans failles.
Bravo.
Pour ce qui est de Kubrick, je suis admiratif devant ses films mais le plus souvent je ne les aime pas. Je ne suis pas un kubrickien.
Je pense également que Stephen King est un auteur majeur de ces 50 dernières années et que son activité au sein d’un genre trop souvent traité avec dédain ne doit pas l’occulter.
Et en plus, son influence sur la pop culture de notre époque est incommensurable. pareil. Un des grands auteurs américain du XX et de ce début du XXIe siècle. On peut même dire que King a façonné tout un pan de la pop culture voire de la culture actuelle.
Je m’étonne un peu qu’en tant que fan de Springsteen par exemple, tu ne sois pas sensible à ces qualités. peut être mais il faut voir ma relation avec Stephen King comme autant de rendez vous ratés. Et pourtant j’ai essayé et j’en ai deux qui m’attendent sur ma PAL (SIMETIERRE et une nouvelle chance-relecture de l’ENFANT LUMIERE).
Je reconnais pourtant toutes les qualités de son écriture, ses thèmes, très proches d’humain ordinaire, du peuple mais je m’ennuie. Et comme indiqué il faut un grand réalisateur derrière pour me faire aimer l’adaptation de ses romans.
Pas aimé du tout l’enfant lumière. Très content de la trahison de Kubrick. Après ce n’est plus exactement la même histoire : OK. Ceux qui crient à la trahison (King le premier) ont bien raison. Moi je suis resté sur les qualités du film (tient cela mériterait un article ; devoir de vacances par exemple).
J’ai très récemment vu l’adaptation de DOCTOR SLEEP et j’ai bien aimé. Quelqu’un l’a vu et/ou lu ?
Vu, mais j’ai trouvé qu’il s’agissait davantage d’un film fantastique que d’un film d’horreur. Les antagonistes ne m’ont pas fait grande impression, et la fin donne l’impression que les héros s’aventurent par mégarde sur le plateau du Shining de Kubrick sans jamais en retrouver l’intensité. Malheureusement pour Doctor Sleep, le retour à l’Overlook invite à la comparaison et cette suite ne peut qu’en sortir perdant
Je l’ai vu au cinéma à sa sortie et, depuis, deux fois dans sa version director’s cut (uniquement en VOst). J’ai beaucoup aimé aussi.
Après, ça reste un produit aseptisé comme la plupart des productions entertainment de notre époque. Ça, il va falloir l’accepter. Le temps des SHINING, BLADE RUNNER, des CONAN LE BARBARE et même des AVENTURIERS DE L’ARCHE PERDUE, c’est mort. Faut arrêter de rêver qu’on va retrouver ce genre de productions intègres. Maintenant, au mieux, tu as un GOG3, qui mélange son cahier des charges tout public (y compris le public de débiles) avec une touche de la patte du réalisateur dedans. Avec Disney omme seul nabab.
Depuis que j’ai accepté cette fatalité, je vais mieux. Je regarde les films et les séries et j’arrive à y prendre du plaisir. Y compris avec les séries STAR WARS, que tout le monde déglingue.
Dans le cas de DOCTOR SLEEP, le film est réalisé, écrit et monté par Mike Flanagan. C’est qui ? C’est un proche de Stephen King mais c’est aussi le showrunner de la série THE HAUNTING (THE HAUNTING OF HILL HOUSE et BLY MANOR) et de l’excellente SERMONT DE MINUIT. Il faut d’ailleurs que je tente sa dernière en date, MIDNIGHT CLUB.
C’est un réalisateur sans épaisseur, mais généreux, qui reste dans les canons des prods Netflix avec ce qu’il y a d’insupportable (c’est woke de partout), mais aussi avec un vértitable amour du genre fantastique. C’est davantage fantastique qu’horreur, comme di JB. Mais là aussi, le genre horreur comme on l’a connu dans les années 80, ça n’existe plus. Va falloir faire avec.
Complètement d’accord avec toi Tornado. On l’a bien vu avec le dernier INDY, on aura plus jamais de films comme les trois premiers de la série, impossible, tout comme les GOONIES. D’ailleurs, tu fais bien de parler de GOG3 car pour le moment c’est le film que je retiens de cette année au ciné (avec le SPIDER-MAN mais c’est de l’animation – et bien que j’aille souvent au ciné, je ne vais pas souvent voir de petits films ou des films d’auteur, juste des franchises ou des films vendeurs ou des films d’épouvante à deux balles).
Et pour Flanagan pareil, d’ailleurs je crois que c’est lui qui a aussi réalisé l’adaptation de JESSIE avec Carla Gugino sur Netflix (et c’est pas mauvais du tout). Bah tiens : brucetringale.com/cet-ete-la-jessie-de-stephen-king/
Donc oui j’aime bien ce réalisateur, comme tu dis, même si BLY MANOR est raté, c’est de la belle ouvrage respectueuse, tout comme les CONJURING sont des bons films. Il faut que je regarde les séries que tu cites tiens.
Oui et Flanagan a fait OCCULUS aussi (THE MIRROR en titre français…parce qu’on est cons en France)
Globalement sa filmo est bonne. Il n’a pas grande épaisseur comme dit Tornado, mais c’est pas un manche non plus et il aime le genre horreur. OCCULUS est un peu flippant quand même. Plus que DR SLEEP.
CONJURING j’ai plus de mal. C’est vraiment du « blockbuster d’horreur » dans toutes ses contradictions. C’est bien fait, pareil c’est James Wan qui n’est pas un manche, mais alors les mus qui explosent, la façon de filmer comme si c’était un film d’action, il n’y a zéro tension/angoisse. Alors qu’on veut te faire peur à des moments. Mais la mise en scène va à l’encontre d’un sentiment de peur. C’est trop dynamique/action.
Et je ne suis pas trop d’accord pour dire que l’horreur de type années 80 c’est fini. Regardez les films de Ari Aster comme HEREDITE. ça rigole moins que CONJURING quoi^^
Je n’ai pas vu tous les films d’épouvante / horreur récents ou qui ont une vingtaine d’années (loin de là) mais j’ai vu HEREDITE et en effet c’est un peu flippant. Mais pour moi c’est plus à rapprocher de ROSEMARY’S BABY, les années 60 quoi.
Et c’est un tout autre genre de production, comme tu dis, CONJURING reste une machine de studio.
SERMONT DE MINUIT : j’ai bien aimé. Regardé au départ pour Zach Gilford (Matt Saracens dans FRIDAY NIGHT LIGHTS). Bonne mini série, qui vaut le détour. Amateurs d’espoir, passez votre chemin.
Je n’ai pas encore terminé MIDNIGHT CLUB, mais les 4 premiers épisodes sont prometteurs.
Pas encore tenté DOCTOR SLEEP. Peur d’être déçu je crois.
Sur vos conseils, j’ai maté SERMONS DE MINUIT (MIDNIGHT MASS en VO, j’apprends donc que « mass » signifie « messe »), les sept épisodes. C’est très beau et bien écrit, de manière générale le prod est top, décors, costumes, FX etc. Pareil pour les acteurs, excellents, la même équipe que pour THE HAUNTING OF (en gros). Le problème c’est que c’est beaucoup trop long, à un moment je ne pouvais plus entendre les citations de la Bible pendant 15 minutes d’affilée. On est typiquement dans une histoire à la King, ça rappelle pas mal de choses du monsieur, en tout cas c’est plutôt bien sur la fin, mais il faut attendre quatre ou cinq épisodes, et encore, les suivants n’évitent pas les longueurs.
J’ai bien envie de me faire MIDNIGHT CLUB, sans doute par complétisme, mais la série, prévue en deux saisons par Flanagan, a été annulée au bout d’une saison par Netflix (ils cassent les couilles, vraiment). Flanagan s’est fendu d’un long post où il expliquait ce qu’il comptait faire pour la seconde saison, je ne l’ai pas encore lu. En tout cas le monsieur part chez Amazon.
C’est quand même cool et très bien joué MIDNIGHT MASS.
Je comprends le côté trop long avec les discours du prêtre, je l’ai ressenti aussi.
Après bon, rien n’est parfait, ça reste une bonne série.
THE HAUNTING OF j’ai eu du mal par contre.
Bon je reconnais que c’est bien fait et tout, mais le constant mélange « flash back/présent » m’a perdu au bout d’un moment.
Je n’ai pas vu la saison 2 BLY MANOR.
Au-delà de ces défauts ça reste très bien oui
BLY MANOR est le moins bon des trois (article de Bibi).
Tiens, j’ai également revu THE GATE récemment. Je préfère PEUR BLEUE pour le coup.
Je t’avoue que mes souvenirs de THE GATE sont flous, il faudrait que je le revoie aussi…
Ah oui, c’est vrai, il y a encore de bons films d’horreur. Ceux d’Ari Aster sont un très bon exemple de films intègres. Le dernier HELLRAISER est excellent aussi. Mais c’est clair que ce sont des exceptions. Des raretés.
Dans l’entertainment pur, le film vraiment grand public, je ne vois pas de films intègres de A à Z aujourd’hui. Éventuellement quelques gros réalisateurs qui ont encore un pied dans « l’ancienne génération », comme Christopher Nolan ou Denis Villeneuve. Et encore. Le DUNE de Villeneuve, c’est pas mal, mais tu sens que le gars fait tout ce qu’il peut pour que son film soit intègre. C’est un peu laborieux. Et au final tu es loin, très loin de l’atmosphère glauque et malsaine de la version Lynch. Il a fait BLADE RUNNER 2049. Mais là encore, tu sens que c’était une exception, genre la « dernière fois que tu voyais ça » et il me semble que ça a été un échec relatif au box-office. Donc c’est pas près de se répéter (un peu comme le dernier MATRIX)…
Je ne vois pas comment ça va se passer dans l’avenir. J’entends à droite et à gauche que les derniers blockbusters, genre INDIANA JONES, font tous des flops par rapport aux attentes des studios. À quoi vont ressembler les futurs blockbusters ? Quels choix prendront les majors pour établir leur cahier des charges dans le futur ?
Je pense aussi aux « géants » de l’entertainment comme Spielberg ou Cameron. WEST SIDE STORY c’était bien, mais READY PLAYER ONE ça va pas du tout. Quant à AVATAR 2, c’est la grève des scénaristes apparemment…
La tendance qui se profile depuis longtemps, c’est le reboot ou la requel (mélange de reboot et prequel), refaire des blockbusters avec les canons de l’époque, comme justement le dernier MATRIX (que j’aime vraiment pas), le nouveau TOP GUN, les derniers SCREAM, JUMANJI etc…
Je suis d’accord pour le DUNE de Villeneuve mais bon, surtout, il n’avait pas son chef op habituel (celui qui claque tout sur BLADE RUNNER 2049 par exemple) et même si c’est moins glauque que certains passages du Lynch, pour avoir revu ce dernier juste avant, il ne tient pas du tout la comparaison dans son ensemble. Le Lynch est mauvais, il vaut juste sur quelques décors / costumes, il y a trois scènes à sauver à tout casser. Le film de Villeneuve ressemble bien plus à un film malgré quelques plans gênants qui font penser à des pubs pour parfum.
En même temps, tu as des blockbusters comme THE FLASH qui sont juste honteux, pas étonnant que cela ne fonctionne pas. AVATAR 2 ne pose pas de souci par son manque de scénario puisque c’était déjà le cas du premier, y a pas tromperie sur la marchandise, un beau spectacle à voir au ciné avant tout.
Le dernier Matrix j’ai pas envie de lancer un débat mais pour moi c’est une purge.
ça se regarde le nombril, ça parle d’auto-critique de façon meta (y’en a marre du meta ! racontez juste une foutue histoire au lieu de faire style que vous critiquez les vilains studios. c’est bien joli, ça fait pamphlet critique mais du coup dans 5 ans ça n’aura plus aucun sens. C’est pas un film ça, c’est un essai sur les politiques des studios de 2022, c’est tout.)
Et en plus en 2eme partie de film ils font tout ce qu’ils ont critiqué. En pas ben en plus. Les scènes d’action sont plates, mal filmées, à des années lumières du premier Matrix.
Pour moi on dirait qu’ils ont honte de ce qu’était Matrix, qu’ils veulent bien faire comprendre que c’était hyper profond (mais au final ça veut dire quoi ? qu’ils n’assument pas que c’était juste cool aussi en termes d’action ? L’action c’est pas bien, faut prétendre que c’était ultra intellectuel ?)
Bref tout ce qu’il faut pas faire…
J’ai trouvé ça à chier. Si c’est à ça qu’on veut que ça ressemble un film d’auteur, moi je fonce voir GOG 3 à la place hein.
Si tu veux de l’action comme les Wachowski savent faire et qui nous fait (entre autres) aimer ces deux soeurs, je te conseille la série SENSE 8.
Il y a les films de Roger Eggers aussi, qu’on aime ou pas, ils sont intègres.
THE WITCH, LIGHTHOUSE.
Bon par contre c’est vrai que THE NORTHMAN déjà on sent que ça devient un poil plus grand public (toutes proportions gardées pour un film de ce mec) et j’ai été un peu déçu de la trame ultra conventionnelle du film.
Roger…je voulais dire Robert Eggers.
On pourrait aussi citer POSSESSOR de Brandon Cronenberg : SF/horreur assez dérangeant. Pas un film génial non plus mais c’est pas du film à cahier des charges.
Le dernier INVISIBLE MAN aussi
THE JANE DOE IDENTITY
RELIC (de Natalie Erika James, déjà réal de BABADOOK)
UNDERWATER
Franchement on en trouve quand même des films d’horreur un peu glauques et pas en mode spectacle de fête foraine.
ça reste peut être des exceptions, mais je pense aussi qu’ils ne sortent pas au ciné et que les gens n’en entendent pas trop parler, mais ils sont là.
L’ère du streaming a entrainé quand même pas mal de distribution plus confidentielle. Et plein de films passent sous nos radars.
Tu as raison (je garde une réserve pour MATRIX parce que déjà tu n’aimes que le premier), mais je parlais surtout pour le « genre » blockbuster. Il y a toujours eu, et il y aura sans doute toujours plus de liberté et donc plus de potentiel en termes d’intégrité pour un film de budget moyen, et un film de série B. Mais pour un film à très gros budget…
J’ai revu MISSION (de Roland Joffé, 1986) : Une grosse production, de la grande aventure, de l’action (même si y a des longueurs), un film d’auteur, un casting de premier plan, des figurants, des conditions de mise en scène extrêmes et hyper compliquées, du grand spectacle, de la reconstitution historique, un scénario irréprochable, une dramaturgie extrême, une toile de fond d’un pessimisme sans égal (tous les gentils crèvent, tous les méchants gagnent), des femmes et des enfants qui se font massacrer sur grand écran avec du sang. Palme d’or à Cannes.
Qui fait encore un film comme ça aujourd’hui ?
Pour le cinéma d’horreur, on voit bien deux sous-genres prendre des directions distinctes : un, très grand public, calibré pour les ados ou les familles, et un autre, plus confidentiel, quasiment hyppé pour les bobos (genre Jordan Peele). Entre les deux, quelques électrons libres arrivent encore à surprendre (le dernier HELLBLAZER, totalement intègre).
De Jordan Peele j’ai bien aimé GET OUT.
ça faisait un peu contes de la crypte le délire final un peu grotesque.
Le reste ça se la joue un peu trop pour rien raconter de spécial en mode « je suis original »
Il me fait un peu penser à Shyamalan qui fait un premier bon film et ensuite tout le monde l’appelle le nouveau Spielberg et il pond des trucs chelou à moitié finis qui reposent sur une promesse de bizarrerie (pour Peele) ou de twist final (pour Shyamalan), souvent creux car c’est dans le cachier des charges avant d’avoir une histoire.
Après tu as sans doute raison pour les gros films. Pas vu THE MISSION cela dit^^
Il y a aussi que les sommes investies dans les films sont devenues stratosphériques.
Jurassik Park, 63 millions.
un film MCU moderne, 250 ?
Et je pense que ça oblige les studios à se caler là dessus pour proposer des spectacles au moins à la hauteur des autres en termes de pyrotechnie, donc faut rentabiliser à mort et inviter les grands parents, les gamins qui viennent de naitre, tout le monde dans les salles^^ Et en plus par rapport à 1986, on est dans un monde où on ne peut plus offenser personne, surtout pas dans un blockbuster sinon c’est la révolution sur les réseaux sociaux (on était peut être mieux sans eux en 1986^^)
En tous cas faut farfouiller un peu pour trouver des films d’horreur/fantastique encore cool.
J’ai vu un seul Jordan Peele (GET OUT) et j’ai détesté.
Et les films de Robert Eggers t’as essayé ? THE WITCH, THE LIGHTHOUSE ?
://www.youtube.com/watch?v=HGQtix20zO8&ab_channel=UniversalPicturesFrance
Tornado a aimé THE WITCH, vachement moins THE LIGHTHOUSE (l’expérience peut être rebutante je le concède)
Pour moi ça reste toujours moins rebutant qu’un film de Lynch mais bon… 😉
Il y a quelques films de André Øvredal qui sont cool (JANE DOE IDENTITY)
Je me suis planté sur Nathalie Erika James, elle a fait RELIC mais c’est Jennifer Kent qui a fait BABADOOK (c’est 2 australiennes, c’est pour ça^^.)
En tous cas les 2 films sont cool. Enfin… « cool ». RELIC faut pas trop avoir du mal à vivre la décrépitude de ses proches qui vieillissent sinon c’est la dépression.
Nope ! Par contre on en avait parlé j’avais été impressionné par MORSE
allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=138365.html
Voui mais là ça commence à dater^^
Enfin 2008 c’est pas « vieux » mais on parlait des tendances actuelles depuis quelques années au cinéma.
Je voulais montrer un trailer ou deux, mais c’est insupportables les bandes annonces. Elles sont toutes montées de la même façon, on dirait qu’il y a un seul mec qui fait ça.
Même un film calme et lancinant, ils vont te mettre des sons de type jump scare dans la bande annonce pour attirer le chalan…
Il y a ça et les musiques pop aussi, qui ne sont parfois pas du tout dans le film et donnent une ambiance complètement fausse dans la bande annonce.
« j’avais été impressionné par MORSE »
Faut regarder aussi BYZANTIUM. J’ai fait l’article (le dernier VAMPIRE SOUS LES SUNLIGHTS), tout le monde a dit « je vais le voir », puis apparemment personne ne l’a fait ! 😀
Tiens c’est comme s’ils avaient fait comme toi quand je te parle d’un film 😉
(je plaisante hein)
Mais oui c’est chouette BYZANTIUM. J’ai le blouré et tout. Je le mettrais pas en film d’horreur cela dit. Plus fantastique, comme ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE.
Oui, oui, c’est parce que là on dérivait sur MORSE…
Hé ! tu exagères ! J’ai regardé moult films que tu m’as suggérés ! Moult ! Et ça va continuer ! C’est juste qu’il faudrait plusieurs vie pour tout voir et tout lire…
Disons que la plupart des fils que vous citez, comme par exemple DELLA MORTE DELLAMORE ou BYZANTIUM, je ne sais pas comment les trouver et je ne peux pas non plus acheter tous les DVDs. Alors imagine ma frustration lorsque je lis les articles sur les films HK ou japonais… Donc voilà, pas moyen de les trouver facilement toutes ces pépites. Même les Jackie Chan c’est galère.
Tu as raison, c’est très compliqué de trouver certains films.
L’abandon des supports physiques est assez pénalisant, puisque tous les films ne trouvent pas d’alternatives en streaming non plus.
Le cinéma asiatique est particulièrement touché…
il y en a régulièrement sur ARTE Replay (gratuit) mais on est dépendant d’une ligne éditoriale snobinarde qui publie deux ou trois grands réals chinois
Avant de déménager, j’ai thésauriser sur mes deux passions les comics et le ciné asiatique et j’ai donc pas mal dépensé de sous, il est vrai.
J’ai désormais la collection que je veux avoir à l’exception peut-être une dizaine de films désormais introuvables à un prix humain. ( les chines ghosts stories, les sens du devoir, les Tiger cage ou l’exorciste chinois)
J’attends des réédition où éventuellement qu’HK puisse louer son catalogue à une plateforme.
Netflix sont quand même les plus variés en la matière,MAIS c’est du récent et beaucoup de contenu exclusifs…
Il faudrait l’équivalent de cunchyroll pour les films HK…
Les éditeurs indépendants font surtout dans le patrimoine et c’est pas vendeur au délà du public de fans fous furieux (Un coffret luxueux sur la filmo de King Hu ne vendra pas au delà de ceux qui l’ont déà en ligne de mire…) et perso j’attends chez Spectrum le coffret GOD OF GAMBLERS dont je suis totalement fan (Chow yun Fat, la classe…^^)
« les chines ghosts stories, les sens du devoir »
J’ai ! J’ai ! (salut Eddy au fait)
Béh voui le ciné asiat j’ai bien conservé mes DVD et je chope des blouré quand je peux quand Spectrum sort des trucs. Mais c’est assez confidentiel.
Mais je l’ai déjà dit, je le répète et je connais des gens d’accord avec moi : le streaming et en particulier le trop grand nombre d’offres contribue à rendre plus difficile la distribution des oeuvres.
Avant t’avais pas la chaine pour le voir, au pire t’attendais la sortie DVD.
Maintenant ça sort même plus parfois et faut s’abonner pour voir le truc et ne jamais le posséder. Et si tu veux voir 3 films mais que pas de bol, ils sont sur 3 services de streaming différents, bah t’es baisé (ou ruiné)
Perso je me jette sur les gialli italiens (les bons) qui sortent chez les petits éditeurs, les gothiques aussi, les films asiat chez Spectrum, etc.
Alors oui faut un budget (mais les bouquins aussi) mais au moins c’est en partie accessible.
Même les trucs récents qui sortent deviennent parfois difficile à voir. Tu veux voir le dernier HELLRAISER ? Prends Hulu ou Disney + (pour Hellraiser, Disney putain !) Sinon…bah tu le verras pas. Pas de sortie physique, aucun autre service de streaming ne le diffuse, etc.
@Cyrille : t’as pas besoin d’acheter TOUS les DVD. Juste ceux qu’on te dit^^
Comment ça, y’en a 6 par article ?
Bon après on peut se filer des fichiers entre nous hein. Mais personne demande. Tornado et moi on le fait, je l’ai fait pour Bruce. On s’arrange.
Surtout que certains DVD sont à des prix exorbitants maintenant car épuisés donc ce serait même pas complètement de la fraude^^
Les films de fantômes japonais dont j’ai parlé dans mon dernier article, j’ai tous les liens pour les voir hein. Et certains ne sont jamais sortis en France ni en DVD ni rien, donc même pas du vol^^
Je viens de mater pas mal de navets récemment : ALONG CAME A SPIDER (je vous laisse chercher), YOU DON’T MESS WITH THE ZOHAN, THE PURGE (dont le sous-texte est pourtant pas inintéressant) et deux PEUR BLEUE en VF : DEEP BLUE SEA (dont le seul intérêt est de voir Saffron Burrows en sous-vêtements) et donc ce SILVER BULLET.
C’est un gros nanar. J’avais lu le bouquin à l’époque, qui, il me semble, était une commande pour avoir une nouvelle par mois sur un calendrier (ce qui est une bonne idée), le problème c’est que je n’en ai aucun souvenir à part que j’avais trouvé ça sympa. Mais le film, c’est pas possible. C’est moche (les FX ont pris cher), la musique est horrible et absolument pas subtile, ça pue les années 80 à plein nez, la plupart des scènes d’épouvante ou de tension sont ridicules (j’ai même ri lors de celle de la poursuite en bagnole), bref un calvaire. Ce qui me donne, paradoxalement, bien envie de revoir SIMETIERRE, sorti quatre ans plus tard, et que j’avais bien aimé à l’époque. Maintenant je pense que je le trouverais bien mauvais; j’imagine.
SIMETIERRE il est ok. Il a un peu vieilli et les FX font parfois kitsch mais pas au point d’être qualifié de nanar. Faut remettre les choses dans leur contexte aussi.
Par contre, j’ai pas vu les 3/4 des trucs de l’article, mais je comprends pas la bonne note des TOMMYKNOCKERS, pour moi c’est complètement kitchissime et involontairement drôle, comme pas mal de téléfilms adaptés de King, avec la première adaptation de IT ou LES LANGOLIERS et autres trucs fauchés des années 90 qui n’ont jamais eu l’air bien fichus, même à leur époque.
IT, quand c’est sorti à l’époque, tout le monde flippait et était accroc. On se disait tous qu’on ne voyait pas passer les 3H. LES TOMMYKNOCKERS était dans cette continuité, même ambiance, même contexte. Et si, si, on trouvait ça hyper bien fichu à l’époque (on avait 16/17 ans).
PEUR BLEUE, on est au moins deux avec Bruce à toujours adorer ça. Je pense effectivement que c’est une question de contextualisation (les années 80, moi je trouve que ça sent bon niveau entertainment). Certains d’entre nous n’ont aucun souci avec les comics de super-héros old-school, d’autres avec les vieux films gothiques de la Universal ou de la Hammer, d’autres avec les films d’horreur des années 80, d’autres avec les téléfilms de cette même décennie, d’autres avec les films de karaté, etc. Chacun semble s’être forgé sa propre contextualisation. Moi, ce que je trouve à chier, c’est le MCU et le DCU moderne, d’autres, c’est le STAR WARS actuel de Disney+, d’autres ? etc, etc…
Même au jeu des comparaisons, je trouve que certains anciens se débrouillent mieux que les nouvelles adaptations. Je pense notamment au Fléau/The Stand, dont je préfère la version 90 à la récente adaptation, notamment grâce à un casting plus marquant (que le Stu moderne est falot !)
C’est une explication attirante, Tornado, mais je ne pense pas que ce soit le cas (pas pour moi en tout cas). Dans ta chronique de PEUR BLEUE, tu cites EXPLORERS et le premier Freddy : il faut que je revoie le Dante, mais le Wes Craven reste bien au-dessus de PEUR BLEUE, et je le sais car je l’ai revu y a pas un an. C’est la crème des films d’horreur, peu de moyens mais des idées de mises en scène, une histoire qui tient la route, des scènes marquantes encore maintenant. Alors qu’il n’y a rien de tout ça dans PEUR BLEUE, c’est mal joué, mal monté, mal réalisé, les personnages ne sont jamais intéressants, ça mélange les ados débrouillards à la E.T. avec de l’horreur classique et sans humour, c’est STRANGER THINGS version ratée. Et le script est cousu de fil blanc, non, vraiment rien à sauver.
Il est dit aussi que ce n’est pas un chef d’oeuvre (PEUR BLEUE)… La comparaison avec EXPLORERS et Wes Craven, c’est pour recontextualiser une époque, pas pour comparer les mises en scènes scrongneugneu ! Après, je suis en total désaccord : Les personnages sont bien écrits (comme toujours avec le King), les acteurs sont épatants (que des pointures, d’ailleurs, y compris le gamin) et l’ambiance est très pulp. Et moi je reste un amoureux du cinéma bis, donc, les petits films nanardesques réalisés avec de l’âme et du coeur, j’adore ça. Je m’y retrouve mieux qu’avec des grosses machines mainstream ou qu’avec des films d’auteurs nombrilistes. C’est un cinéma ou une TV (dans le cas des téléfilms) qui me correspond bien.
LES TOMMYKNOCKERS a un côté soap-opera assumé, une ambiance à la SANTA BARBARA indéniable. Mais derrière, il y a un vrai amour du fantastique et de la SF. C’est cette âme-là qui m’intéresse. À partir de là, je m’en fous si la mise en forme est nanardesque.
Ok mais c’est les arguments qui paraissent trop cléments alors^^
Tu tailles toi-même un film Hammer qui a pris un coup de vieux dans le domaine du kitsch (les vierges de Satan, que j’aime bien) alors que la Hammer c’est aussi un truc que tu aimes.
Et quand on lit ta chronique on dirait qu’il vaut mieux éviter le film. Et là avec les Tommyknockers, qu’on tient une pépite oubliée.
Moi si je devais choisir entre les deux pourtant…
T’es le premier à dire que ceux qui qualifient Captain Kronos de chef d’oeuvre oublié abusent. Si c’est un peu nanar mais qu’on aime faut l’assumer comme tel. Comme les vieux comics, tout ça tout ça…
Ça doit avoir un rapport avec la théorie de la relativité… Si j’avais lu et entendu que TOMMYCKNOCKERS était un chef d’oeuvre, j’aurais fait comme avec CAPITAINE CHRONOS et je me serais peut-être foutu de sa gueule…
Là, peut-être que Cyrille s’attendait à un grand film avec PEUR BLEUE et l’effet a été contre-productif. C’est sans doute quelque chose comme ça.
Moi, récemment, j’ai entendu et lu que Dr STRANGE 2 de Sam Raimi était un film d’auteur, et j’y ai vu la bouse de l’année. Pire, j’y ai vu un film de merde qui foutait en l’air la série VISION. Rien à en sauver. Je garde dix PEUR BLEUE et 10 TOMMYKNOCKERS pour oublier cette chiasse ! 😀
Plus sérieusement, je crois qu’avec le temps, on devient de plus exclusifs : On sait ce qu’on aime et ce qu’on aime pas. Nos critiques sont de plus en plus subjectives.
J’en suis arrivé à constater un truc du même genre au point ou je me demande si ça sert à quelque chose de faire encore des critiques…
J’ai envie de parler de films, d’en faire découvrir, faire le « passeur » mais en fait j’ai l’impression que c’est complètement inutile au final de décrypter, analyser, montrer les qualités. ça sert à rien et tout le monde interprète et apprécie différemment au final…
En plus au final les retours négatifs sont parfois super violents et tu te dis qu’en restant tout seul à parler de rien à personne et à aimer ton truc dans ton coin t’es moins emmerdé^^
Mais pour éviter le rejet complet, on va dire que le format article avec 5 ou 6 films au final ça évite de passer une plombe sur un film qui tombera dans l’oreille de sourds vu qu’au final tout est subjectif.
La lassitude du rédacteur d’articles 😉
J’ai sincèrement réfléchi à un format d’article en mode « liste de films » avec un truc hyper concis « les + » et « les – » du film, une bande annonce et hop emballé c’est pesé.
J’ai plus envie de susciter la curiosité en présentant des trucs que de convaincre.
Oui, même constat de mon côté. Je ne me vois plus, aujourd’hui, refaire un article pour démonter un film qui vient de sortir ou pour en défendre un autre comme le dernier STAR WARS. Effectivement, je préfère, comme toi, tabler sur un article anthologique qui présente des films pour inciter à la découverte. Ça n’empêche pas, comme ici, d’avoir des retours négatifs, mais c’est déjà plus varié dans les commentaires.
Présenter un film, c’est de toute manière plus constructif et fédérateur que de le critiquer. Aujourd’hui, c’est ce que je préfère en tout cas.
Alors pour répondre à ta question, Tornado, je ne m’attendais pas à un chef d’oeuvre en voyant PEUR BLEUE, mais à un petit film sympathique comme j’en avais le souvenir avec THE GATE ou SIMETIERRE, voire FREDDY en effet. Mais tout est tombé à côté.
DR STRANGE 2 n’est pas une bouse mais ce n’est pas non plus un film d’auteur c’est clair, c’est un film calibré qui permet à son réalisateur quelques touches personnelles. C’est déjà pas mal.
Pour les questions existentielles, c’est un credo pour moi depuis longtemps : je présente un truc qui m’a plu, je n’en fais pas une analyse ni ne prétend « savoir », ça évite complètement les déconvenues et les discussions parfois stériles. Le choix est simple : expliquer pourquoi on a trouvé ça bien ou pas. Et de préférence, ne parler que de ce qu’on trouve enthousiasmant ou inspirant (même en mal).
Non mais les Tommyknockers y’a une nana possédée/alien machin qui utilise un rouge à lèvres laser avec des SFX dignes de Xena la guerrière, c’est joué de manière hyper caricaturale, on dirait parfois une parodie de SF. A quel moment ça fait le moindre petit effet flippant ? Tu prends des films de SF de la HAMMER comme THE QUATERMASS EXPERIMENT ça fait + flipper. Et ça a 40 ans de plus.
Note que je n’ai rien dit sur PEUR BLEUE pour ma part, j’ai pas vu.
Mais les téléfilms adaptés de King comme TOMMYKNOCKERS, LANGOLIERS je peux pas. Vraiment…
Je pense que l’attachement à King et à ses histoires + la nostalgie doit jouer un rôle dans leur appréciation parce que vraiment quand on ne connait pas du tout, je ne sais pas ce qu’on peut trouver à ces adaptations.
Je pense que certaines histoires de King ont un côté grotesque qui peut être inquiétant à l’écrit, mais adapté à la va-vite par quelqu’un qui ne cherche pas à utiliser correctement le langage cinématographique pour transposer le concept à l’image, ça vire vite au ridicule complet.
Un Junji Ito adapté n’importe comment ce serait pareil…
DREAMCATCHER, le coup du parasite en soi…c’est inquiétant sur la papier, mais tout le délire caca prout du film et les tronches pas possible que tirent les acteurs en surjeu total, t’es à moitié mort de rire parfois…
J’ai regardé le film 1408 de 2007, encore une adaptation de Stephen King. C’est sympa, y a un ou deux moments saisissants mais ça reste un peu classique, ça rappelle pas mal les thèmes de Shining. Pas un mauvais film.
Comme la plupart des adaptations du King. Ça a commencé très fort dans les 70’s et le début des 80’s, avec des réals comme Stanley Kubrick, Brian DePalma, George Romero, David Cronenberg, John Carpenter, Tobe Hooper (impressionnant), puis ensuite c’est tombé de plus en plus dans de la série B.
On est parti de l’underground pour ensuite tomber dans de l’entertainment de plus en plus cheap. Dommage.
Je reste quend même fan des adaptations du King, même en constatant que c’est devenu moyen.