Encyclopegeek : Les adaptations Ciné-TV de Stephen King
1ère publication le 19/02/16- Mise à jour le 25/08/20
Un dossier de: TORNADO
Cet article portera sur l’œuvre de Stephen King dans le registre des adaptations, principalement au cinéma et à la télévision…
L’illustration de couverture est utilisée avec l’aimable autorisation du dessinateur Fabrice Le Henanff. Merci à lui.
Maître du fantastique et de la peur, grand Manitou des geeks, spécialiste du suspense et des ambiances à mystères, celui que l’on surnomme le « King » est avant tout un créateur littéraire de premier plan. Boudé par l’intelligentsia et l’élite du monde de la littérature dite « sérieuse » (celle qui n’aime pas la littérature de genre et plus généralement le domaine du fantastique), le bonhomme n’a pas attendu d’être reconnu par ses pairs écrivains pour nous livrer une œuvre d’une richesse sans égale dans la création contemporaine.
Parce qu’il plait avant tout aux jeunes et aux geeks, aux fans d’histoires à donner le frisson et à tous les garnements du monde entier, sa présence dans les pages virtuelles mais non moins réelles de Bruce Lit était d’emblée une évidence. Cet article sera d’ailleurs complété de quelques autres mettant en lumière, à chaque fois, une de ses œuvres en particulier.
Je vous propose aujourd’hui un tour d’horizon afin d’explorer les thèmes de prédilection qui parcourent l’œuvre de l’écrivain. Et ce à travers quelques films soigneusement sélectionnés…
Alors soyez prêts à trembler dans vos chaumières, pauvres mortels !
1) Préambule
Pourquoi les films ? Et pourquoi pas directement les livres ?
J’entends d’ici les puristes grincer des dents tout en se préparant à m’immoler sur l’autel impie de la dénaturation, parce que les œuvres de Stephen King, ce sont avant tout ses romans et ses nouvelles !
C’est vrai.
Toutefois, cela fait maintenant quarante et un an que ses écrits sont publiés et pas moins de trente neuf ans qu’ils sont adaptés sur un écran, qu’il soit petit (la télévision) ou grand (le cinéma) !
Les adaptations de l’œuvre de Stephen King, ce sont avant tout des noms prestigieux comme ceux de Stanley Kubrick, John Carpenter, Brian De Palma, David Cronenberg, Tobe Hooper, George A. Romero ou Rob Reiner. Aucun doute, la chose est depuis longtemps sortie du cadre du livre pour devenir des images, des icones totalement épanouies dans l’art multimédia et la culture geek. Au point que l’écrivain lui-même se soit adonné à l’exercice de ses propres adaptations à maintes et maintes reprises, allant même jusqu’à s’essayer à la mise en scène (le film Maximum Overdrive), au jeu d’acteur (Creepshow) et à l’écriture du scénario (nous y reviendrons plus loin).
Ainsi, on peut l’écrire, le dire et même le crier sans risque : Stephen King et les adaptations, ce sont des épousailles réussies qui s’apprêtent à fêter leurs noces d’or. Et il est fort probable que ce mariage survive à l’écrivain lui-même, tout comme ses livres…
Si aujourd’hui il n’est nullement question de minimiser la valeur des livres pour eux-mêmes (certains étant de toute manière quasiment inadaptables), il est néanmoins possible de célébrer celle de leurs adaptations comme une communion de tous les médias (on en trouve également au rayon des comics), et un terrain de prédilection pour nous, les geeks…
Les pendules ayant été remises à l’heure, on peut à présent se pencher sur ce qui fait la richesse de l’œuvre de notre écrivain favori : Ses thèmes.
Les histoires écrites par Stephen King, ce sont effectivement des thèmes constamment recyclés en boucle. Parmi eux, on trouve en premier lieu ceux de l’enfance et de la séparation entre le monde des adultes et celui des enfants. Deux thèmes liés qui vont traverser l’œuvre et revenir à maintes reprises, qu’ils soient développés de manière frontale ou au contraire sous-jacente, voire traités en arrière-plan. De la même manière, on va souvent retrouver celui des relations entre la littérature et le réel (l’écrivain donnant corps à ses fictions par le pouvoir de l’écriture), celui du problème des addictions (Stephen King ayant souffert d’une longue et pénible période d’alcoolisme et autres dépendances), ainsi que le charme vénéneux de la région du Maine, les dissonances au sein de la cellule familiale, la critique sociale par le biais de la vie dans les petites villes, et enfin celui de la maison maudite…
Ainsi, plus d’une nouvelle ou un roman traite du mal qui s’immisce dans le quotidien d’une bourgade, utilise le décor de la forêt comme métaphore de la peur de l’inconnu, et fait naître le mal incarné dans une comptine pour enfants…
la science-fiction et les extraterrestres sont toujours abordés non pas comme une fin, mais comme un moyen de développer, par exemple, la peur de grandir ou encore, et c’est le thème le plus savoureux de tous, cette parabole sous-jacente qui dénonce la fragilité de l’équilibre social américain, où les aspects négatifs de la nature humaine en général sont exacerbés face à la moindre perturbation surnaturelle…
Je vous propose à présent de visiter quelques films emblématiques, histoire de vérifier la thèse selon laquelle l’œuvre de Stephen King est d’une richesse sans commune mesure et qu’elle demeure, comme nous l’aimons chez Bruce Lit, une preuve bien réelle que la culture geek, c’est de la culture tout court…
2) Ça : Homme des années 80…
Adaptation du roman fleuve de Stephen King, Ça est un téléfilm réalisé en 1990 par Tommy Lee Wallace, diffusé à l’origine en deux parties sous sa forme télévisuelle.
Soyons honnêtes : « Ça » a beaucoup vieilli. « Ça » ne fait plus vraiment peur et trahit son âge, vieillissement prématuré accentué par sa forme télévisuelle. Mais pour autant, la force du roman de Stephen King est toujours présente et, si l’on a aimé un tant soit peu le film à l’époque, on se laisse volontiers reprendre par la main tout au long de ces trois heures qui s’écoulent sans ennui et sans temps mort, car le script est superbe, parfaitement découpé et dialogué.
Les effets spéciaux ont beau être obsolètes (aïe aïe aïe ! cette araignée géante dans le combat final…), le soin apporté aux décors dans la partie « années 50 » et la mise en image des apparitions surréalistes du clown maléfique demeurent très réussis.
Tel un vieux film fantastique rendu kitsch par le poids des ans, Ça est sans doute réservé à un public de nostalgiques l’ayant découvert à l’époque de sa sortie. Mais en lui-même, il s’agit d’un téléfilm de haute volée, réalisé avec sincérité, qui adapte assez librement le roman originel, tout en parvenant à préserver l’esprit initial du récit de Stephen King.
Ça fait d’ailleurs partie de ces films sur l’adolescence qui auront marqué toute une génération de jeunes spectateurs au cours des années 80, avec Stand by Me (un autre Stephen King !), Les Goonies, et Explorers, à travers lesquels les adolescents se reconnaissaient et avec lesquels ils tissaient des liens inviolables…
Avec son récit teinté d’autobiographie, Stephen King a écrit une parabole proprement géniale sur le passage entre l’enfance et l’âge adulte. Car derrière cette malédiction qui s’abat tous les trente ans sur cette petite ville du Maine, se cache en réalité la métaphore la plus incisive sur la difficulté de grandir, principalement lorsque l’on est différent. C’est ainsi que les « Sept Paumés », sept enfants de onze ans réunis par leurs différences et leurs faiblesses (le gros, le binoclard, le bègue, le noir, la fille, l’asthmatique et le juif), vont s’allier afin de vaincre « Ça », une entité maléfique qui s’en prend aux plus faibles lorsqu’ils sont esseulés et fragiles.
A maintes reprises, il est montré que les habitants de Derry, la petite ville (fictive et reprise dans d’autres récits de l’écrivain, tel Dreamcatcher) dans laquelle se déroulent les événements, se détournent du mal lorsqu’ils le voient, même sous sa forme la plus anodine. C’est ainsi que tout le monde préfère ignorer les vies absolument sinistres de nos sept petits héros et laisser le mal s’immiscer là où on ne fait que l’apercevoir…
« Ça » incarne donc aussi bien la peur de grandir, notamment dans un monde cruel qui écrase les êtres un tant soit peu différents, que la cécité d’une société qui s’est détournée des valeurs humaines élémentaires (l’entraide, la protection du plus faible) en se réfugiant dans l’ignorance, par pure lâcheté. Le « clown maléfique » n’est en somme que la matérialisation d’un mal domestique, tapi en chacun des habitants, qui s’abreuve à la source des maux les plus anodins, afin de grandir et de gagner en puissance…

La dure vie des sept paumés ! © Warner Home Video / source Stephen King Wiki
C’est en retrouvant ces valeurs élémentaires que nos jeunes héros vont réussir à vaincre « Ça » une première fois. Mais sans doute encore trop faibles puisque non accomplis, ils devront revenir trente ans plus tard, adultes, réaliser le combat final.
Là encore, il y aurait beaucoup à dire sur ces quadragénaires modèles en apparence (ils pratiquent tous un métier prestigieux), mais toujours meurtris par leur adolescence effroyable, au point qu’ils aient préféré l’oublier, tout en étant incapables de se consacrer à leurs propres enfants, qu’ils n’ont jamais eu… Il faudra donc qu’ils retournent à la source de leurs maux pour affronter « Ça » de nouveau, afin d’accomplir leur victoire contre la vie. Mais hélas, tous n’y parviendront pas…
C’est ainsi que malgré ses défauts d’œuvre vieillissante au look suranné, Ça réussit le tour de force de préserver l’esprit et la portée philosophique du roman de Stephen King, au contenu à priori inadaptable, sachant qu’avec tout ce que j’ai évoqué plus haut, je n’ai sans doute fait qu’effleurer la richesse thématique qui se cache dans le sous-texte ! Pour cette première raison, il mérite sa place au panthéon des meilleures adaptations du maître du fantastique, quand bien même il n’est qu’un téléfilm. Et pour ceux qui l’ont découverts dans leur jeunesse, sa place d’œuvre culte…
Une nouvelle adaptation, cinématographique cette fois, est prévue depuis quelques années. Sans cesse repoussée, elle est aujourd’hui programmée pour être tournée à l’été 2016.

Grippe-sou, l’éternel clown qui fait peur ! © Warner Home Video / Source : Bloody Disgusting!
3) The Shining : Light my fire
a) Version 1980
Tout le monde a vu ce film culte aujourd’hui, non ?
Réalisé en 1980 par le grand Stanley Kubrick, il s’agit de l’une des premières adaptations cinématographiques d’un roman de l’écrivain (le deuxième, après Carrie).
Une petite famille (le père, la mère et le tout jeune fils) s’installe pour l’hiver dans un grand hôtel de luxe qui n’est ouvert que l’été. Car Jack Torrance (le père), qui sort d’une douloureuse période d’alcoolisme, voit ainsi l’opportunité, en acceptant la maintenance de l’hôtel durant sa période hivernale de fermeture, de reconstruire sa vie auprès de ses proches. Jack projette également, en dehors de ses moments de travail de maintenance, de se mettre à l’écriture.
Jack est un homme de bonne volonté mais son tempérament colérique l’a jusqu’ici desservi. C’est le terreau sur lequel l’hôtel Overlook, doté d’une conscience et habité par des esprits malveillants, va s’appuyer afin de le posséder. Mais l’esprit de l’hôtel convoite surtout Danny, le fils de jack. Car Danny possède le « Shining » (le « don de lumière »), une faculté de médium extrêmement puissante, qui le rend sensible aux forces surnaturelles et lui permet de voir l’avenir. Si l’hôtel parvenait à tuer Danny et à intégrer son esprit au sien, il pourrait ainsi posséder ses pouvoirs…
En plein cœur de l’hiver et alors que l’hôtel est quasiment inaccessible en raison de la neige qui l’isole, Jack finit par devenir un danger pour sa famille…

De célèbres images de terreur…© Warner Home Video / Source : Mentalfloss
Stephen King écrit son roman Shining, l’Enfant Lumière en 1977. C’est sa troisième publication et, avec le recul, on s’aperçoit qu’elle canalise déjà une grande partie de ses thèmes récurrents.
L’écrivain y développait une intrigue horrifique qui n’était finalement que le vernis derrière lequel il dressait une éprouvante mais passionnante toile de fond sur la détérioration de la cellule familiale. L’hôtel, qui isole cette famille du reste du monde social et la confronte à elle-même, canalise ainsi toutes les menaces qui pulvérisent son équilibre (l’alcoolisme, les déviances du quotidien comme la maltraitance de l’enfant due aux colères parentales, l’effritement des sentiments amoureux, la précarité financière et la perte de confiance) en les exacerbant, afin de déverser sa malveillance naturelle, comme une métaphore de cette détérioration.
Kubrick n’a gardé que la surface de cette passionnante toile de fond, se focalisant essentiellement sur la perte de repères des personnages et leur basculement vers la folie. A ce titre, le réalisateur n’a évidemment pas son pareil pour magnifier une simple épure de la trame du roman initial. Ne gardant que quelques éléments du script originel, il parvient ainsi à en proposer une relecture simplifiée mais dont les effets purement cinématographiques tirent l’ensemble par le haut.
Avec un tel réalisateur, tout est affaire de mise en scène conceptuelle. Le thème du labyrinthe, véritable métaphore de l’esprit torturé des principaux personnages, s’impose ainsi de manière physique et allégorique, comme une mise en abîme : Dans l’esprit des personnages, dans les couloirs de l’hôtel, dans le jardin. Il est décliné partout.
L’équilibre entre la présence et l’absence des habitants de l’hôtel est également mis en scène de manière complexe et maniaque : Tandis que les fantômes n’apparaissent dans le cadre que de manière ponctuelle mais centrée, les vivants se reflètent sur tous les coins de l’image par un jeu de reflets de tous les instants (sur les miroirs, dans les fenêtres, etc.). Soit une façon purement cinématographique de développer certains des thèmes puisés ici et là dans le roman initial, auxquels s’ajoutent des effets horrifiques saisissants, qui n’ont pas pris une ride contrairement à la plupart des films d’horreur de la même époque…

Le labyrinthe de l’esprit… © Warner Home Video / Source : Curbed
C’est un fait établi : La peur en iconographie ne survit pas au poids de l’âge, et le cinéma, qui allie l’image et le son (deux vecteurs de peur s’il en est), n’échappe pas à cette règle indéniable : Ce qui nous faisait peur il y a des décennies ne nous fait plus peur aujourd’hui. La peur « vieillit » mal, car elle est dépassée dans le temps par de nouvelles itérations.
Mais ce Shining de 1980 demeure toujours assez effrayant, et ce malgré une image surannée qui semble directement surgir des années 70 ! Les effets sont pourtant simples, voire archétypaux quand on y pense : Deux petites filles fantomatiques qui apparaissent brutalement dans un couloir au tournant d’un virage ; des flots de sang qui dégoulinent d’un escalier ; un gros plan sur le visage d’un enfant déformé par la peur ; une vieille femme décrépite qui avance vers la caméra en exultant d’un rire sépulcral ; une musique à faire pâlir d’angoisse un mur de pierre… Mais effectivement, rien que d’y penser on en frissonne d’angoisse ! Au point que, bien des décennies plus tard, la plupart des réalisateurs de films d’horreur continuent de réutiliser de tels effets !
Mais cette débauche de trouvailles cinégéniques s’oppose à une certaine « trahison » de l’intrigue imaginée par Stephen King. Raison pour laquelle de nombreux lecteurs n’ont pas apprécié cette adaptation, qui fait l’impasse sur beaucoup trop d’éléments issus du roman, et en transforme beaucoup d’autres. Il convient néanmoins de préférer la version longue et ses 25 mn supplémentaires rajoutées au montage, qui ramènent beaucoup d’éléments jadis écartés en provenance du roman, réhabilitant ainsi un certain nombre de détails le rendant plus proche du roman initial.
Stephen King regrettera néanmoins ce manque de fidélité envers son œuvre, au point qu’il sera l’initiateur d’une nouvelle adaptation en 1997 (près de vingt ans plus tard), dont il écrira le scénario en personne, en plus de produire le film et de superviser sa mise en scène. Le résultat sera à la fois très différent et très complémentaire de la version de Stanley Kubrick, substituant à l’expérience sensorielle de l’un (la première version de 1980), la richesse thématique de l’autre…
B) Version 1997
En 1997, une nouvelle adaptation voit ainsi le jour sous la forme d’une mini-série en trois parties de 87 minutes réalisée par Mick Garris, un habitué des adaptations de l’écrivain (on lui doit notamment La Nuit déchirée, Le Fléau, Riding The Bullet, Desolation et Bag of Bones !).
Beaucoup plus longue que la première version, cette seconde mouture développe ainsi davantage les thèmes de son auteur, notamment celui de la maison maudite, ici transformée en hôtel de luxe…
King a imaginé un cadre édifiant pour illustrer cette descente aux enfers : Construit par un homme malfaisant et dont l’histoire est parsemée de tragédies, de suicides suspects et de meurtres atroces, l’hôtel a fini par tisser des liens malsains et surnaturels avec l’esprit de ses défunts clients, des mondains jouisseurs à la morale déviante. Ainsi, cette construction de l’homme devient le réceptacle de toutes ses malveillances inconscientes, qui se retournent contre les âmes égarées et se déchainent lorsque celles-ci sont isolées et en proie à leurs propres tourments.
L’écrivain reprendra ce dernier thème bien des années plus tard, lorsqu’il imaginera le scénario de la mini-série télévisée Rose Red dont nous reparlerons plus bas…

Une famille modèle ?© Warner Bros / Source : Imdb
Cette mini-série télévisée ne doit pas être considérée comme un remake du film de Stanley Kubrick, mais plutôt comme une nouvelle adaptation voulue la plus fidèle possible par Stephen King lui-même, très impliqué dans sa conception.
Si l’écrivain respectait la version de Kubrick pour ses qualités strictement cinématographiques, il ne cachait pas sa déception en termes d’adaptation. Il souhaitait depuis longtemps s’atteler à une nouvelle version, afin que ses propres thèmes soient bien présents et que toutes les scènes évacuées ou transformées par le réalisateur de 2001 : l’odyssée de l’espace soient restituées de manière fidèle et développées en harmonie avec sa propre vision du récit.
Ainsi, de nombreux détails absents de la version de 1980, ou différemment exploités, sont cette fois repris scrupuleusement, l’ensemble étant rendu possible étant donné la très longue durée du téléfilm (plus de 4h15 !).
Si la forme télévisuelle de cette nouvelle adaptation joue forcément en sa défaveur, avec une mise en scène un peu froide et des effets spéciaux assez limités (et ce malgré un budget conséquent de 25 000 000 $), le résultat n’en est pas moins extrêmement réussi. A la base de cette réussite, il y a évidemment l’écriture généreuse de Stephen King, qui soigne comme à son habitude la caractérisation des personnages principaux, qui vibrent d’une humanité riche et complexe. Le personnage de Jack Torrance (quand bien même Steven Weber ne parvient pas à nous faire oublier Jack Nicholson) s’impose ainsi comme un individu aux multiples facettes, capable d’embrasser une multitude de sentiments ambivalents.
Les acteurs sont tous de solides artisans et le casting est dans l’ensemble très réussi, avec une magnifique interprétation de Rebecca de Mornay (la mère) et une présence habitée du tout jeune Courtland Mead (le fils). Pour le reste, les vétérans Melvin Van Peebles, Eliott Gould et Pat Hingle complètent ce casting de manière optimale.

Un père modèle ? © Warner Bros / Source : Arrêt Sur Séries
Les spectateurs les moins impressionnables pourront toujours faire la fine bouche, mais le résultat est pour le moins prenant et angoissant. Et ces trois parties vous réservent de grands moments de terreur glaçante et viscérale, avec des instants bucoliques et envoûtants traversés de fulgurances tétanisantes (le sommet étant évidemment atteint à l’intérieur de la « Chambre 217 »).
La mini-série avance ainsi inexorablement vers une descente aux enfers qui met à rude épreuve les nerfs et la résistance du spectateur, qui assiste à la destruction de la famille Torrance comme s’il en faisait partie, vivant ses tragiques et épouvantables événements de l’intérieur, isolé avec elle au milieu des neiges angoissantes et infranchissables du Colorado.
La peur va et vient au rythme des séquences et, paradoxalement, s’intensifie lorsqu’il ne se passe rien. Je m’explique : Si les apparitions des esprits de l’hôtel ne sont pas effrayantes (à l’exception de la femme de la « Chambre 217 » et de quelques fantômes masqués), toutes les scènes où la menace est hors champ sont quasi-insoutenables. Et c’est dans ces moments d’attente interminable, lorsque l’on se demande ce qu’il va se passer au son d’une musique angoissante au plus haut point, que le cœur se met à battre avec d’autant plus d’empressement…
Le film est ainsi extrêmement bien rythmé et équilibré, et l’on suit ces quatre heure quinze avec une addiction sans faille.
Certainement l’une des adaptations des romans de Stephen King parmi les plus réussies.

Que cache donc la chambre N°217 ? © Warner Bros / Source : No Real Danger
4) Salem’s Lot : Quand on arrive en ville…
Le pitch : L’écrivain Ben Mears est de retour à Jerusalem’s Lot, sa ville natale, dans le Maine. Il compte écrire un roman autour de la maison des Marsden, un vieux manoir abandonné, isolé sur la colline qui surplombe la ville. Mais il apprend que la maison vient d’être vendue par un promoteur à deux étrangers : Richard Straker & Kurt Barlow, des antiquaires.
Lorsqu’il était enfant, Ben était entré dans la maison alors qu’elle était encore habitée par ses propriétaires. Et il avait assisté, par un incroyable concours de circonstances, à la mort de ces derniers. Comme pour exorciser ses vieux démons, Ben entreprend l’écriture de son roman afin de tirer un trait définitif avec ces douloureux souvenirs.
Peu à peu, tandis que le mystérieux Kurt Barlow n’a pas encore fait son apparition, certains enfants de Jerusalem’s Lot commencent à disparaitre dans des conditions étranges. Le mal serait-il de retour à Marsden House ?
Comme ce fut le cas pour Shining, Les Vampires de Salem (Salem’s Lot en VO) a connu deux adaptations. Soit deux téléfilms fleuves, le premier datant de 1979, et le second de 2004, tous-deux initialement diffusés en deux parties.
La première version est réalisée par un Tobe Hooper encore auréolé de son Massacre à la Tronçonneuse qui s’implique dans une adaptation très ambitieuse, de même que ses deux stars, James Mason et David Soul, notre « Hutch » bien aimé !
Au départ prévue pour durer quatre heures, cette adaptation est réduite à une durée de 184 minutes, souffrant au final d’un montage donnant au film un aspect un peu incomplet. Sans doute très effrayant lors de sa première diffusion, notamment grâce à des maquillages et des effets horrifiques saisissants, il souffre désormais du poids de l’âge et affiche une patine kitsch qui risque de déplaire aux jeunes générations.
Pour autant, cette première version demeure relativement fidèle au roman initial et elle bénéficia à l’époque de l’adoubement de Stephen King, l’élevant au rang des meilleures adaptations des œuvres de l’écrivain.
Replacé dans son contexte, le film est effectivement très honorable et se regarde avec plaisir. Bien qu’il y manque un certain nombre d’éléments en provenance du roman (notamment tous les souvenirs d’enfance de Ben Mears), il bénéficie d’une production ample (décors impressionnants, bande-son de grande qualité) qui lui permit d’ailleurs d’être diffusé dans les salles de cinéma (notamment en France), hélas dans une version tronquée de 112 minutes assez calamiteuse, qui resta la seule visible jusqu’à la sortie du DVD en 2007, offrant au film la mauvaise réputation qu’il ne méritait pas !
Pour l’essentiel, Les Vampires de Salem version 1979 demeure un modèle pérenne puisqu’il va initier le principe des mini-séries télévisées, servant de terrain idéal aux adaptations des plus longs romans de Stephen King. Un modèle toujours utilisé de nos jours.
L’enfant vampire. Monstre ou victime ?
La seconde adaptation se décline également sous la forme d’un téléfilm de 181 minutes, réalisé en 2004 par Mikael Salomon.
Cette seconde version est excellente en tout point. Dans la mesure évidemment où les puristes ne doivent pas non plus espérer une transposition littérale du roman…
Le casting haut de gamme additionne la présence de Rob Lowe (Ben Mears), Donald Sutherland (Richard Straker), Rutger Hauer (Kurt Barlow) et James Cromwell (le père Donald Callahan). La réalisation est ambitieuse et bénéficie des moyens à la hauteur de l’entreprise.
La musique est particulièrement somptueuse, gothique et lugubre à souhait. Composée par Patrick Cassidy et Christopher Gordon, avec la présence de Lisa Gerrard (du groupe Dead Can Dance) pour les vocalises, elle mérite à elle seule le détour (le CD est une grande réussite dans le genre). L’atmosphère lugubre du score sied d’ailleurs parfaitement à la noirceur et à la mélancolie du roman de Stephen King, à cette ambiance unique qu’exhale l’état du Maine et cette partie du nord de l’Amérique, perpétuellement baignée de pluies et de brumes.
Le film en lui-même est à la fois très classique entant qu’histoire de vampires, et totalement envoûtant (c’est quand même une histoire de Stephen King !). Dominé par la voix-off de Rob Lowe qui retranscrit littéralement le texte de l’écrivain, il se déroule sans temps mort et résiste bien au poids des ans, puisque je la regarde toujours aussi volontiers à peu-près une fois par an, généralement lors des fêtes d’Halloween…
Bien évidemment, son format télévisuel possède ses limites et ce n’est pas un film d’auteur. Inutile, donc, de chercher à le comparer à du Stanley Kubrick. Il ne s’agit que d’un divertissement, gentiment horrifique, mais racé et superbement mélancolique.
Comme de coutume avec les œuvres de l’écrivain, les personnages sont très habités et les lieux suintent une aura mystérieuse à l’atmosphère unique en son genre. Atmosphère parfaitement rendue par le film de Mikael Salomon.

Marsden House, la maléfique… © Warner Bros / Source : Universal Monsters Universe
Dans la perspective de l’œuvre de Stephen King et des thèmes dont nous parlions plus haut, il est aujourd’hui impressionnant de relever, à travers cette simple histoire de vampires, l’épaisseur et la richesse du sous-texte. Et de constater à quel point certains des thèmes récurrents de l’auteur de Carrie viennent former sa structure littéraire.
Parmi tous ces thèmes qui reviennent en boucle dans les lignes du maître du fantastique, trois sont particulièrement à l’œuvre dans les lignes de Salem’s Lot :
– le thème du Passage douloureux de l’enfance à l’âge adulte (à l’œuvre dans Ça ou Stand By Me) est pleinement incarné par le personnage du jeune Mark Petrie, le seul à survivre à l’épidémie. De même que les souvenirs de Ben Mears le ramènent à sa douloureuse expérience en la matière, symbolisée par son entrée dans la maison des Marsden, comme un rite de passage traumatisant entre les deux âges…
– Le thème de l’Ecrivain en quête de rédemption est également très représenté. Comme ce sera aussi le cas à maintes reprises (La Part des Ténèbres, Désolation ou Sac D’Os), King met en scène le personnage d’un écrivain qui cesse d’écrire, sortant ainsi du confort de l’imaginaire afin de lutter contre le mal de façon concrète. Une manière pour l’auteur lui-même de signifier, entre les lignes, ses regrets et ses angoisses de ne pas vivre pleinement le réel durant toutes ces longues heures passées à écrire…
– Enfin, et davantage encore que les autres thèmes précités, celui de la Ville consumée par le mal et de la Maison maudite comme point névralgique de ce mal, traverse Salem’s Lot comme une fulgurance. Là encore, on retrouve cette thématique dans bien d’autres œuvres de l’écrivain, qu’il s’agisse de ses romans ou de ses scénarios directement écrits pour le cinéma ou la télévision (Le Bazaar de l’Epouvante ou Les Tommyknockers pour la ville, Shining ou Rose Red pour la maison).

Retour aux sources du mal, pour l’écrivain Ben Mears (Rob Lowe)… © Warner Bros / Source : Stephen King Wiki
Dans Salem’s Lot, la maison Marsden, véritable personnage à part entière, est devenue maudite depuis que ses habitants ont tissé avec elle des liens malsains (ils y sacrifiaient des enfants). Elle sera le centre d’une déflagration, une réaction en chaine qui contaminera la ville entière, répandant le mal comme une épidémie. Voilà donc que les habitants de Jerusalem’s Lot, jadis éprouvés par les abominations perpétrées à Marsden house, abominations qu’ils préférèrent ignorer plutôt que d’affronter le mal, doivent désormais assumer les retombées de la malédiction qu’ils refusèrent de lever par le passé.
Soit une manière symbolique, une parabole pour exprimer les maux de nos sociétés, notamment lorsque les valeurs humaines élémentaires (entraide et protection du plus faible) sont abandonnées par la communauté, qui préfère se réfugier dans la cécité et l’ignorance, dans la lâcheté la plus totale…
C’est dire toute la richesse du script de Stephen King, qui s’élève bien au delà d’une simple histoire de vampires pour embrasser le terrain de la fable, voire du mythe, alors que l’écrivain n’en était, en 1975, qu’à son second roman à peine…
5) Rose Red : La maison du diable !
Rose Red est une mini-série télévisée réalisée en 2002 par Craig R. Baxley et diffusée à l’origine en trois segments d’une durée de 1h25 environ. Le scénario est rédigé par Stephen King en personne. Il s’agit d’un scénario original, que le romancier a écrit spécifiquement pour le tournage de la mini-série (il ne s’agit donc pas de l’adaptation de l’un de ses romans).
A l’origine, King souhaitait écrire le remake du film La Maison du Diable, réalisé en 1963 par Robert Wise (au vu de ses thèmes de prédilection, on comprend pourquoi !). En 1990, le romancier approcha Steven Spielberg mais les deux hommes ne s’entendirent pas du tout sur le résultat. Stephen King se détourna du projet et Spielberg le produisit de son côté avec le réalisateur Jan de Bont. Hantise sortit ainsi en 1999 et se traine depuis l’une des pires réputations (complètement justifiée !) de nanar de l’histoire du cinéma d’épouvante…
Au début des années 2000, Stephen King est victime d’un accident de la route. Choqué, il entame une thérapie en reprenant son projet de maison hantée à la base. S’il préserve le point de départ du script de La Maison du Diable (un professeur de parapsychologie invite un groupe de personnes possédant des aptitudes psychiques à intégrer une maison réputée hantée afin de mener une expérience paranormale), qui était à l’origine un roman de Shirley Jackson, il dévie ensuite de cette ligne narrative pour développer sa propre intrigue. Il reprend alors le décor d’une véritable maison possédant la réputation adéquate (la mystérieuse « Maison Winchester », dont l’intérieur est aménagé de manière complètement incohérente, un peu comme si la maison s’était construite elle-même de façon capricieuse !), qu’il déplace de la Californie à Seatle.
Ensuite, King va jouer sur les poncifs du genre en préparant une campagne publicitaire basée sur le fameux postulat « inspiré d’une histoire vraie », qui est devenu l’apanage des films de maison hantée (on se souvient d’Amytiville la Maison du Diable dont certains pensent encore qu’il s’agissait quasiment d’un documentaire !). Il laisse alors finement entendre qu’il existe quelque part « le journal intime d’Ellen Rimbauer », la jeune femme qui habita le manoir Rose Red, dans lequel de nombreuses personnes disparurent de manière mystérieuse, et qui est devenue sa principale source d’inspiration…
Par delà les réseaux sociaux, la rumeur se répand et Rose Red devient ainsi la nouvelle maison hantée sur laquelle il faut compter ! La production demande alors à l’écrivain Ridley Pearson d’entamer la rédaction du roman Le Journal d’Ellen Rimbauer, qui narre la genèse de Rose Red et dont l’adaptation télévisuelle (excellente aussi) sera tournée en 2003 !
Ainsi s’est développé le projet de cette histoire que Stephen King rêvait d’écrire depuis son enfance.
Le film est plutôt réussi du haut de ses 4h15 ! L’atmosphère est envoûtante à souhait, notamment grâce au décor de la maison qui, évidemment, demeure le personnage principal du récit.
Plutôt que de reprendre les codes de la peur suggérée comme l’avait magistralement développée Robert Wise dans La Maison du Diable, King va multiplier les divers effets d’épouvante sans le moindre complexe et jouer sur tous les codes cinématographiques de la peur : Maison qui tremble, pièces qui se transforment, silhouettes fantomatiques qui se déplacent trop vite pour que l’on puisse les voir (comme dans le sublime Les Innocents réalisé par Jack Clayton en 1961), apparitions fantomatiques sous forme vaporeuse ou au contraire sous l’apparence de zombies décharnés, zoom précipités sur le visage horrifié des protagonistes, travellings contrariés jouant sur les courtes focales (le fameux « trans-trav » d’Alfred Hitchcock !), musique ténébreuse, statues effrayantes qui paraissent habitées par les démons, envahissement des éléments hostiles de la nature (plantes et racines, abeilles, corbeaux)… Tout y passe !

Welcome to Rose Red…© Warner Bros / Source : écranlarge
A l’arrivée, le résultat est extrêmement classique dans le fond et ne fera peur qu’aux spectateurs les plus facilement impressionnables. Mais les qualités de l’ensemble se trouvent ailleurs : Soignant la caractérisation de ses personnages en prenant bien soin de les développer de l’intérieur et de contourner les archétypes du genre (point de manichéisme primaire), Stephen King maintient un suspense constant grâce à une écriture riche et dense, qui évite les dénouements attendus.
Comme à son habitude, l’écrivain parvient à injecter une toile de fond pleine de sens en imaginant cette maison construite avec des pierres du vieux continent transportées dans le « nouveau monde », dont la mise en chantier est initiée par un homme mauvais, qui épouse une femme qu’il va peu à peu souiller de ses déviances (souvent sexuelles). Eprise de sa maison davantage que de son mari, la jeune femme va tisser des liens malsains avec la demeure, qui développera de manière vengeresse et ostentatoire toutes ses malveillances inconscientes (soit le même thème abordé de manière plus ou moins proche dans Shining et Salem’s Lot)…
Malgré un casting assez lisse (si l’on excepte les personnages de Nick et Emery, incarnés par des acteurs plus habités que les autres) et une fin manquant de surprise et de panache, le film vaut le détour et s’impose comme une solide itération sur le thème de la maison hantée, qui en propose un florilège assez édifiant. Bien filmé, superbement photographié et parsemé d’effets spéciaux très réussis, Rose Red s’inscrit au panthéon des films de maison hantée avec une force certaine qui contentera les amateurs de frissons surannés et d’ambiance ténébreuse, le tout construit autour d’une script soigné et généreux. Et si l’ensemble manque d’originalité, il ne manque pas de charme…

La quintessence de la maison hantée © Warner Bros/ Source : écranlarge
6) The Night Flier : La plume de la nuit
L’air de rien, ma sélection est frustrante car j’aurais envie d’ajouter encore un certain nombre d’adaptations afin de nourrir mon sujet !
Dreamcatcher, les Tommyknockers, Désolation, La Tempête du Siècle, Stand By Me, La Part des Ténèbres, Le Bazaar de l’Epouvante, Bag Of Bones sont autant de films et de téléfilms qui apporteraient de l’eau à mon moulin sur le terrain des thèmes littéraires qui parcourent l’œuvre de Stephen King.
Je terminerai néanmoins par The Night Flier (Les Ailes de la Nuit en VF), petit film sans prétention qui figure pourtant parmi mes préférés dans le registre des adaptations du maitre du fantastique.
Il s’agit d’un film d’horreur réalisé par Mark Pavia en 1997. La nouvelle homonyme de Stephen King (intitulée Le Rapace Nocturne en VF !), avait été publiée dix ans plus tôt dans le recueil Rêves et cauchemars.
Le synopsis : Richard Dees est un journaliste qui officie pour le tabloïd « Inside View », un journal spécialisé dans les images choquantes et les meurtres les plus abjects. Il réussit à obtenir les meilleurs sujets (c’est-à-dire les pires au niveau du contenu abominable) de par son tempérament sans concession, cynique et grâce à sa vitesse de déplacement (il possède un petit avion particulier).
Il s’intéresse désormais à une série de meurtres commis par un sérial-killer qui se déplace également grâce à un biplan et fréquente les petits aéroports où il massacre certains des habitants. Apparemment, le meurtrier, qui se fait appeler Dwight Rainfield (« Dwight » = le prénom de l’acteur ayant interprété le personnage de Rainfield dans le Dracula de 1931, avec Bela Lugosi), se prend pour un vampire…
A l’origine, The Night Flier fait partie intégrante de l’œuvre de Stephen King et développe l’un des thèmes favoris du romancier, où la littérature se mêle au réel, l’écrivain donnant corps à ses fictions par le pouvoir de l’écriture. Le personnage de Richard Dees incarne ainsi la face damnée de l’écrivain, c’est-à-dire le journaliste people, le journaliste à scandale, celui qui met sa plume au service de ce que l’écriture possède de moins noble, afin d’attirer le lecteur par des procédés racoleurs et sordides qui lui permettent de vendre un maximum de papier sans la moindre déontologie.
Au bout d’un moment la question va alors se poser, implacablement : Et si Dwight Rainfield était une création directement issue de ce jeu macabre de la course au fait divers toujours plus choquant et effroyable ? Un postulat fascinant, que le script va utiliser afin de maintenir un suspense croissant…
Ainsi se développe une réflexion vertigineuse à base de similitudes entre la presse à sensation et le vampirisme, renouvelant par la même occasion le mythe des créatures suceuses de sang ! L’analogie entre le journalisme et le vampirisme devient alors évidente dès lors que sont mis en lumière les procédés détestables et la soif de sang de certains journalistes de tabloïd parmi les moins scrupuleux…

Et si Dracula avait un avion ?© New Line Cinema / Source : Radiator Heaven
Le film en lui-même pourra ne pas plaire à tout le monde. Tout d’abord il est particulièrement gore et violent, porté par des personnages plutôt déplaisants. A ce titre, le choix de confier le rôle principal à Miguel Ferrer (le fils de José Ferrer) est un coup de maître, l’acteur faisant preuve d’un charisme à toute épreuve en réussissant à incarner un personnage à la fois antipathique et fédérateur, auquel le spectateur s’attache malgré sa personnalité extrêmement négative.
L’atmosphère du film (soutenue par une musique à la fois mélancolique et inquiétante) est envoûtante et réussit parfaitement à retranscrire celle des histoires de Stephen King, qui évoluent la plus-part du temps dans les paysages angoissants de l’état du Maine, au nord de l’Amérique.
La mise en scène manque sans doute de relief et le résultat oscille entre la production cinématographique, le téléfilm et la série TV haut de gamme. Mais si je devais choisir, je dirais que le film, dans la forme et dans le style, s’apparente à un excellent épisode de la série X-Files, ce qui en soit est une qualité !
Pour ma part, il s’agit d’un film que j’adore et de l’une des adaptations du King parmi mes préférées. Ainsi, bien que The Night Flier s’apparente à une bonne petite série B davantage qu’à un grand film fantastique, je le trouve vraiment très réussi.
Ainsi s’achève ce tour d’horizon.
J’espère humblement avoir apporté ma pierre à l’édifice consistant à démontrer à quel point l’œuvre de Stephen King est riche et que nous nous frottons ici à l’un des principaux créateurs littéraires de notre temps.
C’est dire oh combien l’intelligentsia ayant conspué le bonhomme depuis maintenant plusieurs décennies est à côté de la plaque et comme le mépris affiché de l’élite intellectuelle pour le genre fantastique (et horrifique) est tenace.
Heureusement que la nation geek ne s’est pas laissé avoir et a célébré l’écrivain au point qu’il soit devenu une icône culturelle destinée à briller au firmament des auteurs phares de notre domaine de prédilection, aux côtés d’Edgar Alan Poe, H.P. Lovecraft, Arthur Conan Doyle, Robert E. Howard, Michael Moorcock et J.R.R. Tolkien…
Petit anecdote : King est également, comme un grand nombre de geeks, un musicien amateur. Il a ainsi fondé un groupe de rock (entant que guitariste) avec Matt Groening et le chanteur Al Cooper (et d’autres écrivains que je ne connais pas) : Rock Bottom Remainders !
Bien évidemment, on pourrait encore étendre le procédé et aborder les domaines de la bande-dessinée avec des créations comme American Vampire ou Stephen King : N auxquelles il est associé. De même que les adaptations de ses romans de plus en plus nombreuses qui voient le jour sous ce medium, comme Le Fléau (12 tomes chez Delcourt), La Tour Sombre (une quinzaine de tomes pour une série toujours en cours de publication), ou encore des transpositions comme Creepshow par Bernie Wrightson ou des projets associés à son fils Joe Hill (Road Rage, chez Panini). Et puisque l’on parle de Joe Hill, ce n’est pas la moindre des « créations » de Stephen King que ce fils prodige qui nous a déjà offert la fabuleuse série Locke & Keys, ici déjà chroniquée à plusieurs reprises…
Alors que Dieu prête vie à cette famille fantastique, passée maîtresse dans le domaine de la peur…

Quand Maître King fait le clown… Source : Stephen King France
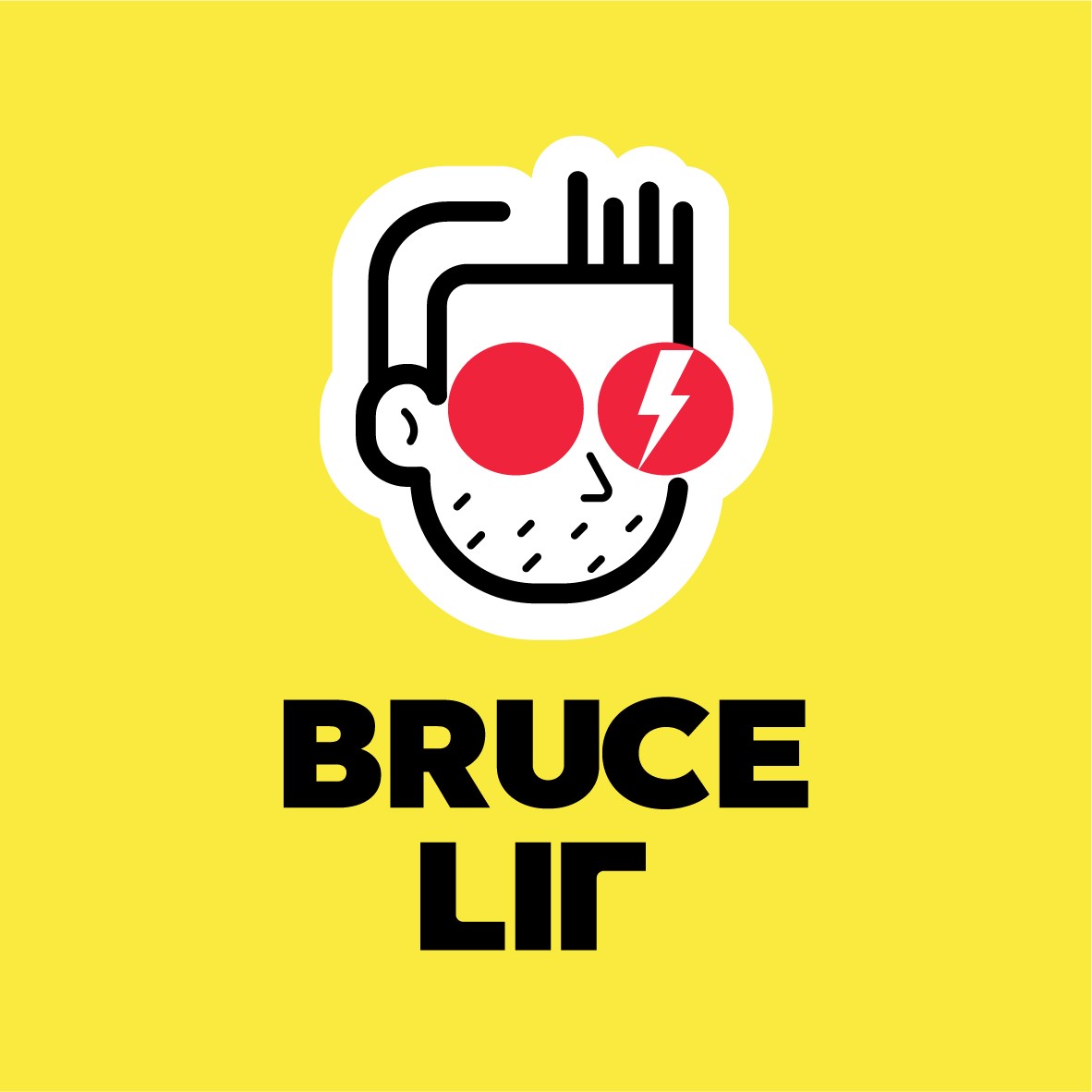


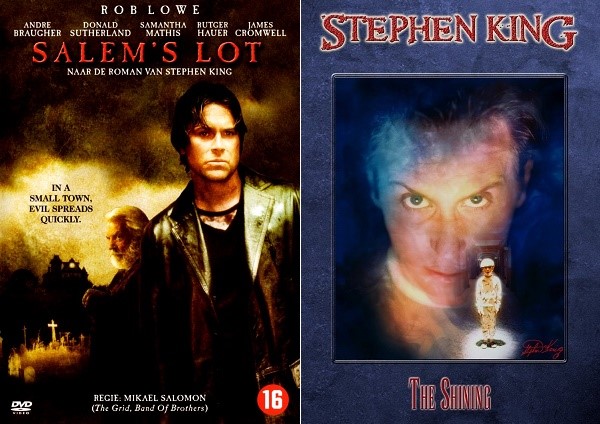




Encore un herculéen article fleuve à l’actif de Tornado !
Je l’ai attaqué mais je vais me le faire par petits bouts…
Premières impressions : superbe choix d’illustrations mêlant le créateur à ses créations ! Ton introduction est aussi très stylée.
L’aveu honteux : je n’ai jamais vu Shining, je le connais juste à travers une parodie des Simpsons (encore eux !)
Le pinaillage : les noces d’or c’est 50 ans, pas 40 ans, non ?
1) Préambule – Élever les adaptations cinématographiques de Stephen King au rang de genre en soi, il fallait oser, Tornado l’a fait, et je suis convaincu. Comme JP Nguyen, je vais reprendre le concept de l’article fractionnable, et le lire en plusieurs fois.
La liste des thèmes principaux dans l’œuvre de l’écrivain produit un étrange effet. A la fois, on se dit que ses livres sont bien plus que de simples récits pour filer le frisson, à la fois (de manière très injuste), on se dit qu’il exploite toujours les mêmes filons. C’est bien sûr injuste puisqu’il ne s’agit que de 2 ou 3 thèmes et ça occulte sa capacité à créer et faire exister des personnages, à créer des lieux.
« Boudé par l’intelligentsia et l’élite du monde de la littérature dite « sérieuse » (celle qui n’aime pas la littérature de genre et plus généralement le domaine du fantastique) » : c’est rigolo, c’est exactement le point de départ de mon article à venir sur Alice Cooper !!! A mon connaissance, King est fan de Métal, mais je ne connais aucune allusion transversale à l’univers de l’un et de l’autre.
Portion Shining : J’ai le coffret Kubrick à la maison, et j’apprends qu’il contient sûrement les 25 minutes en plus du film ! Un film que je ne trouvais pas assez violent durant mon adolescence comme le Psycho d’Hitchcock ou l’Exorciste.
Les thèmes que tu soulèves tout au long de l’article me font prendre conscience de la parenté entre les écrits de King et le cinéma de Lynch que j’adore : l’horreur qui se cache derrière la famille, le couple, les banlieues résidentielles, tout ceci étant synthétisé dans Blue Velvet qui pourrait être finalement un scénario King.
depuis le temps que j’entends que le film de Kubrick n’est pas conforme au bouquin….tu m’as donné envie de voir le téléfilm en tout cas, puisque jusqu’à présent la comparaison avec le film me semblait tellement écrasante. A ce propos, c’est la chambre 237 et pas 217 non ?
// Stephen King : je réalise que j’ai lu pas mal de ses bouquins, vu la plupart de ses films et que j’aime presque tout. Je me rappelle du roman « Jessie » où une femme se retrouve menottée seule en pleine cambrousse après que son mari décède en plein coït en l’ayant attachée. Il n’y a que lui pour écrire des trucs pareils ! Un roman où la nana se demande comment se libérer et se rappelle de son père incestueux. King est vraiment l’écrivain de la surface qui remonte….
Maintenant, avec lui ou d’autres artistes, j’ai un problème avec les artistes trop prolifiques. Je serais incapables de vous citer le nom des 5 derniers bouquins du King, ce type écrivant à la vitesse de l’éclair.
A ce propos il est aveugle ou pas ?
@JP : Presque des noces d’or !
@Présence : Tous les auteurs ont leurs thèmes de prédilection, non ? Je trouve que Stephen King en a un bon paquet ! Une dizaine environ !
@Bruce : C’est bien la 217.
« Jessie » : Encore un roman où il n’y a pas de fantastique. Il fait partie de sa « trilogie féminine », avec « Misery » et « Dolores Claiborne ». Mais c’est le seul qui n’a pas été directement adapté.
Sinon, comme toi, j’ai du mal à le suivre, et je me contente désormais des adaptations, qui sortent à un rythme moins soutenu… C’est la même raison qui m’a fait lâcher Woody Allen ou les frès Cohen. Ils vont trop vite pour moi.
J’ai tapé trop vite, et du coup, il manque un mot qui change tout le sens de ma phrase. Je voulais écrire :
C’est bien sûr injuste puisqu’il ne s’agit PAS que de 2 ou 3 thèmes.
Je voulais lire cet article aujourd’hui mais je ne trouve pas le temps ! En tout cas je rejoins JP sur l’iconographie, c’est très réussi. J’adore celle avec le dôme. J’ai un peu regardé la série issue du livre (Under the dome) mais je n’ai pas tout vu : cela avait l’air amusant et pas trop mal fait.
Je reviens dès que j’ai plus de choses à dire !
2) Ça : Homme des années 80… Pour une fois, j’ai tout de suite repéré la référence à Femmes des années 80 (finalement, je ne sais pas si je devrais m’en vanter tant que ça). Je n’ai pas vu le téléfilm, et je garde une impression très vague du roman. Ton commentaire me rappelle cette sensation très bien rendue par Stephen King, de ces adolescents en marge des autres, sans pour autant être des cas sociaux ou des individus incapables de relation sociale.
« Ca » : je l’avais vu il y a bien des années sur M6 et ça m’avait foutu les jetons pendant une semaine. Je ne le reverrai pas sauf sous la torture. Plus jamais ça.
Du coup, quand je lis que Tornado considère que c’est une des adaptations qui fait le moins peur, je passe mon chemin pour le reste. A part peut-être pour Salem’s Lot, pour voir David Soul dans un autre rôle que celui de Hutch…
Présence nocturne :
« Hail to the King » 4/4
Et si les adaptations d’œuvres de Stephen King constituaient un genre en soi ? Ce n’est pas une idée si farfelue que ça, surtout au vu du nombre. Tornado a opéré une sélection inspirée, et il vous en parle avec passion, de Ça à Night Flier, en passant bien sûr par Shinning de Stanley Kubrick.
@Tornado : permets moi d’insister mais je crois que j’ai raison : Room 237
Night Flier : encore un exemple de la prolifération du bonhomme ! Je ne connaissais pas ! Il faut absolumment que je vois ça !
Dwight Rainfield : enfin un point commun avec Alice Cooper ? The Ballad of Dwight Fry ?
C’est quoi N ?
Ah oui. Tu as raison. A ma décharge, il apparait « Chambre 217 » sur divers sites. 🙁
Après un séjour sur Wikipedia, on a tous les deux raisons : la chambre 237 pour le film de Kubrick, la chambre 217 pour le roman de King.
Ah, je me suis amusé à chercher pourquoi : c’était une demande de l’Hôtel Timberline Lodge ,qui a servi au tournage, qui ne voulait pas se trainer une chambre maudite : la 237 n’existe pas en vrai dans l’hôtel. Mais paradoxalement, la 217 est depuis très demandée…
Pour les inconditionnels de The Shining, il y a un doc classieux et obsessionnel, dont le titre est une illustration de vos échanges
http://www.imdb.com/title/tt2085910/?ref_=fn_al_tt_1
Oui, Mr Sloane….L’article est fini sur celui-là….Il arrivera dans le cycle « Théories du complot »
@Cyrille : magne toi, le cycle Rock commence…..demain !!!
@JP : Non mais quelle chochote ! 😀
Franchement « Ça » et le premier « Salem » ont tellement vieilli que c’est surtout leur côté kitsch qui fait peur !
Je t’encourage vivement à revoir « Ça », tu y trouvera tout ce que tu as aimé dans « Stand By me ».
@Bruce : Je ne suis pas convaincu que « Les Ailes de la Nuit » puisse te plaire. C’est surtout un petit film d’atmosphère, même si je trouve le sujet passionnant. Vois-le plutôt comme un épisode d’X-Files, une série B un peu gore.
Moi, j’ai été traumatisé par « Cimetière » à l’époque de sa sortie. Et le bouquin m’avait également fait flipper à mort ! Je me souviens en avoir lu la fin chez un bouquiniste à Rennes. Je le lisais debout, au milieu des rayons, et j’étais terrifié !
Aujourd’hui, la plupart des gens trouvent qu’il également mal vieilli et qu’il est très kitsch. Mais le dernier quart d’heure me terrifie toujours autant. Ce gamin mort-vivant, c’est atroce ! Et qu’est-ce que c’est désespéré ! 🙁
3) The Shining : Light my fire – C’est passionnant de pouvoir découvrir ainsi comment 2 réalisateurs ont réalisé 2 adaptations de nature différente d’un même livre. Dans la mesure où tu as présenté le film d’un grand réalisateur comme Stanley Kubrick, je me demande pourquoi tu n’as pas inclus l’adaptation réalisée par David Cronenberg.
Il y avait également John Carpenter, Brian De Palma, George A. Romero, Rob Reiner, Brian Singer et Frank Darabont !
Je dois avouer que Dead Zone ne figure pas parmi mes préférés et qu’il ne rentrait pas spécifiquement dans la démonstration.
J’ai de l’affection pour The Dead Zone, principalement à cause de mon admiration sans faille pour Christopher Walken, qui incarne un personnage kingien avec Johnny Smith de façon aussi mémorable que Jack Nicholson avec Jack Torrance trois ans auparavant.
Sur le plan de ta démonstration, Jonnhy Smith incarne un prof de littérature qui vit dans le Maine. Suite à un accident et un long coma, il découvre qu’il possède des pouvoirs psychiques et qu’il peut prévoir l’avenir. Il interviendra notamment dans une petite ville pour découvrir qu’elle abrite en son sein un tueur en série (une scène marquante avec des ciseaux qui permet à Cronenberg de marquer durablement les esprits).
C’est une adaptation fidèle au roman original mais où Cronenberg amène sa personnalité et son sens du décalage dans la partie fantastique, et où Walken apporte un supplément d’âme et l’attachement du spectateur à un personnage marqué par le destin.
Tu as raison d’insister. Il faut que je le revoie. Le truc c’est que je l’avais trouvé extrêmement kitsch la dernière fois que je l’ai vu (plus encore que les autres adaptations). Mais c’est d’accord, je vais lui redonner ça chance et peut-être sa place dans le panthéon.
Personne n’a répondu à cette question qui m’empêche de dormir ! Stephen King n’était pas censé devenir aveugle ?
Le scan avec la cloche m’évoque The Mist qui était très chouette avec une partie de l’équipe du futur show TV Walking Dead. Le bocal évoque aussi bien celui sous lequel les X-Men sont enfermés dans Second Coming que Girls des frères Luna qui, Tornado si tu arrives à faire abstraction des dessins, est un récit purement Kingiesque !
« The Mist » m’avait fait une très forte impression mains je ne l’ai pas revu depuis.
De ce que je sache, Stephen King n’est pas aveugle. Mais le risque de le devenir est important à plus ou moins court terme.
The Mist a un peu vieilli avec ses trucages un peu kitsch qui font très « téléfilm » par contre le final est toujours aussi grandiose avec la musique de Dead can dance qui illumine littéralement le film ! Ce long métrage appartient à la curieuse catégorie des films sauvés par leur fin !
@ Tornado : j’arrive après la bataille mais une fois n’est pas coutume bravo pour cet article Tornadien en diable : didactique clair et riche en enseignements !
Entièrement d’accord avec toi, notamment sur cette étrange catégorie de films sauvés par leur fin ! (souvenir de « Tigre et Dragon » qui n’aurait jamais été le même film sans cette fin sublime, voire même « Blade Runner » pour en parler une fois encore !).
4) Salem’s Lot : Quand on arrive en ville… – Cette partie de ton article me permet de mieux comprendre pourquoi le thème de l’écrivain revient régulièrement dans l’œuvre de Stephen King, et ce en quoi ce n’est pas une répétition d’un livre à l’autre. Je suis totalement convaincu par la manière dont tu expliques que les miniséries télé (en 2 ou 3 parties) ne sont pas des pis aller, faute d’avoir le budget nécessaire pour faire un film, mais constitue des œuvres à part entière.
C’est un cap cette chro, Tornado, que dis-je, c’est une cap? C’est une péninsule!
Sur laquelle Mel Brooks a tout le loisir de célébrer Stephen avec le bonheur qui transpirait des eighties, c’est la vie…
https://www.youtube.com/watch?v=UVoMH5GUFRo
Ah ah j’avais oublié ce titre, Lone ! Bien vu !
Bon faut vraiment que je lise tous les Encyclopegeek en retard… dont celui-ci.
Stephen King et mes années lycée. Je suis passée du Club des 5 à lui! en commençant pas le Fléau (plus de 1000 pages)! (et oui on avait pas toutes ces collections de romans pour ado lorsque j’étais jeunette). Plus tard j’ai vu ses adaptations en films. La performance de Kathy Bates dans Misery !
@Frede : que ce soit à la maison, ou en bibliothèque il faut bien une étagère entière pour caser tous ses bouquins non ?
@Bruce : ouais, j’ai vu pour la semaine rock ! Pfff je suis vraiment lent c’est horrible. Je sais pas comment vous arrivez à écrire autant. J’ai une chro en chantier (j’adorerai te l’envoyer cette semaine) et une bonne douzaine en vue, mais j’avance au compte-goutte. Je me hais des fois.