American Gods par Bryan Fuller
AUTEUR: ALEX NIKOLAVITCH
1ère publication le 07/09/17- MAJ le 18/11/18
VF : Studio Canal
American Gods est une série en 8 épisodes de 60 minutes tirée du roman éponyme de Neil Gaiman.
Ah, il est loin, le temps où Neil Gaiman débarquait dans les comics en repompant allègrement tout ce que faisait Alan Moore. Bon, il avait une excuse, vu que c’était plus ou moins sa feuille de route. Mais les premiers Sandman et Black Orchid, par exemple, se situent dans la continuité directe des Swamp Thing du wookie de Northampton, jusqu’à l’utilisation des personnages oubliés des anthologies d’horreur des années 70, qui avaient été remis au goût du jour dans les pages consacrées à la Créature du Marais. (notons qu’on sait que c’était un cahier des charges, vu que quand il reprend Animal Man et Doom Patrol, Grant Morrison semble avoir à peu près le même).
Petit à petit, Gaiman s’était émancipé. On avait vu son potentiel dès ses premiers boulots plus personnels, comme Violent Cases avec Dave McKean. Si les grandes thématiques étaient souvent les mêmes, Gaiman les intellectualisait beaucoup moins que son modèle, il y mettait beaucoup plus d’affect et ça se sentait.
Flash forward. Gaiman devance Moore en se mettant au roman, adaptant au départ sa propre série télévisée Neverwhere passée sur la BBC en 1996. Il faut dire que les moyens alloués à la créa à l’époque par la vénérable institution britannique sont loin d’être ce qu’ils sont à présent, et que déçu du résultat (pourtant plein de fulgurances), Gaiman tient à en donner sa vision. Et il y prend goût, le bougre. Il en signera par la suite des paquets, des bouquins, dont pas mal seront adaptés en comics, juste retour des choses, mais aussi au cinéma, comme Stardust et Coraline, lui permettant de toucher le très grand public.
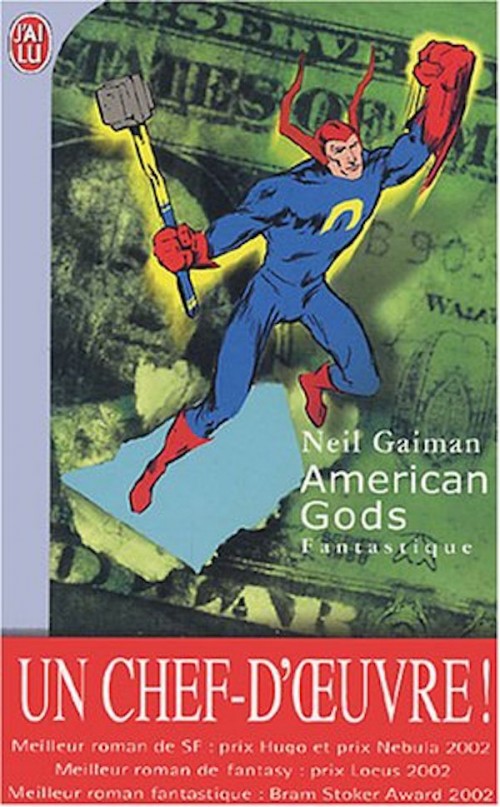
Ça m’épate toujours, la façon dont les gars qui font les couvertures peuvent parfois faire du gros hors sujet en se croyant très malins.
Mais si son premier contact avec la télé a été décevant, la lucarne est devenue entretemps l’endroit où ça se passe. Le cinéma hollywoodien est désormais trop formaté, trop verrouillé par des producteurs échappés d’écoles de commerce et de management et appliquant à la lettre des manuels de recette et des cahiers des charges. Si l’on veut tirer sur écran la substantifique moelle d’une œuvre, lui donner la place de se déployer, c’est en série télé qu’on y arrive, de nos jours. Et du coup, son gros pavé American Gods est arrivé cette années chez Starz.
Alors c’est quoi, American Gods ? Au départ, un roman racontant comment le taulard Shadow Moon est recruté à sa sortie de prison par un mystérieux Mr. Wednesday, et se retrouve propulsé dans un monde dont il n’avait pas conscience, ou plus précisément dans l’arrière boutique du monde qui lui était familier. Car de nouveaux dieux ont émergé à notre époque, comme les médias et la technologie, et les anciens dieux qui n’ont pas su pactiser se rebiffent et se préparent à un baroud d’honneur.
On y retrouve tout plein de thématiques chères à l’auteur, déjà vues dans Sandman et Neverwhere, par exemple, et réexploitées ensuite, sous une autre forme, dans Coraline et Nobody Owens. Les concepts et archétypes qui s’agitent sous la surface des choses, déjà. Le vieillissement des concepts, et donc des dieux qui se fondent sur eux. L’humanisation de ces concepts, et ses conséquences fatales.
Alors, que dire de la série ? (je ne parlerai que de la série TV. Je sais qu’il y a une adaptation en comics, mais j’ai pas vu du tout à quoi ça ressemblait, et en fait, j’ai même pas cherché à voir).
Le résultat est visuellement assez étrange. Si le showrunner Bryan Fuller s’est bien installé dans le paysage avec Pushing Daisies et Hannibal, imposant une patte esthétisante qui se retrouvera ici, mais distordue par un côté un poil clinquant (mais thématiquement pas absurde), son comparse Michael Green inquiète plus : scénariste du récent Logan, il a aussi trempé dans Alien Covenant (ainsi que dans Molleville et dans le film Green Lantern).
Côté acteurs, les noms qui ont vite surnagé étaient ceux de Ian McShane, un vétéran des vieux de la vieille (il a tourné dans son premier film en 1962, et il avait crevé l’écran dans Deadwood, ce qui ne nous rajeunit pas non plus) et de Gillian Anderson (vue dernièrement dans Hannibal et le retour des X-Files, et qui impressionnait fort dans The Fall).
Le reste du casting principal est moins connu. Ricky Whittle, qui joue Shadow, n’a pas brillé jusqu’alors, et semble surtout là pour sa belle gueule et ses biscotos. Emily Browning avait été vue dans Sucker Punch, pas le Snyder le plus réussi, ce qui en dit long au vu de la filmo de Zack l’épate. Mais s’arrêter sur son cas permet de définir la force de toute la série : la miss parvient à être hyper craquante, même quand elle joue une morte vivante ultra glauque. Et quand je dis glauque, la série met le paquet pour insister sur ce point, entre les mouches qui lui tournent autour, les cicatrices d’autopsie qui craquent, le teint qui vire au bizarre et le fait qu’il lui arrive de tousser des asticots.
Et malgré cela, elle parvient à porter le personnage et à le rendre absolument touchant. Et toute la série réussira à se poser sur ce fil là, équilibrant des fulgurances grotesques (la volée de flèches reçue par le Viking dès les premières secondes de la série) et des scènes de cul (hétéro et homo, ça vaut le coup de le signaler au passage) qui pourraient sembler gratuites et sordides, mais ont à chaque fois du sens, des moments d’inquiétude pure et d’autres d’humour au troisième degré (Wednesday/McShane est incroyable sous ce rapport, parvenant à être menaçant un plan, et redevenir un petit vieux inoffensif et presque ridicule l’instant d’après).
Côté seconds rôles, Gillian Anderson semble s’amuser comme une petite folle : elle joue la déesse des médias, et se grime pour l’occasion en Lucille Ball (la vedette de la sitcom I Love Lucy, mais elle fut aussi productrice sur Mission Impossible et Star Trek, excusez du peu), en David Bowie, en Marilyn Monroe et et Judy Garland, mais on peut aussi saluer les performances de Peter Stormare, qui campe un Czernobog immonde et terrifiant ou Crispin Glover (George McFly! ) en Mister World, antagoniste principal aussi inquiétant que discret.

Insérez ici une blague sur Scully et Life on Mars.
Source Indiewire
© 2017 Starz Entertainment, LLC / Studio Canal
Mention spéciale à Pablo Schreiber (le frère de Sabretooth) qui campe un farfadet aussi improbable que complètement destroy, ainsi qu’à Bruce Langley en Technical Boy coplètement tête à claque mais complètement conçu pour. Et n’oublions pas Anansi, joué par Orlando Jones, qui pourrait avoir le droit à un spin-off puisque ça a été le cas en roman, avec Anansi Boys.
En termes d’écriture, la série approfondit certaines choses tout en collant assez bien au déroulé du roman. C’est un récit initiatique somme toute classique, avec un Shadow Moon découvrant graduellement un monde de magie (s’il est épaté par la révélation de l’identité de Wednesday, tout lecteur qui connaît même très vaguement la mythologie nordique ou a lu trois épisodes de Thor chez Marvel a pigé en dix minutes qui est ce petit vieux habillé de terne avec un œil louche, qui ment comme un arracheur de dents et se passionne pour les histoire de pendus).
Si la patte Fuller baigne l’ensemble, elle n’étouffe pas pour autant la voix de Gaiman. La séquence avec la vieille égyptienne et la Mort, ou celle sur la vie de la petite irlandaise envoyée en exil sont typiques de l’auteur.
La critique de la société américaine (parfois brutale et frontale, parfois beaucoup plus subtile) est aussi typique du regard assez extérieur que lui porte Gaiman. S’il vit en Amérique depuis longtemps, il reste fondamentalement anglais, porte un regard acidulé sur, par exemple, le culte des armes à feu, ou l’omniprésence de la figure d’un Jésus que chacun accommode à sa sauce.
Quand arrive la fin de la première saison, le spectateur comprend qu’elle n’était qu’une mise en jambe, que le plat de résistance est encore à venir.
Alors, ce n’est pas exempt de défauts. Globalement, American Gods me fait penser, à sa façon, à la série télé tirée de Preacher (quoiqu’AG soit plus fidèle, sur le fond). Alors, j’ai beaucoup aimé Preacher (je sais que ce n’est pas le cas de tout le monde ici) (mais comme qui dit Preacher dit Garth Ennis, je me sens exceptionnellement autorisé à lever un gros doigt à la cantonade en faisant des bruits obscènes avec ma bouche) (mais bon, je vous fais un cœur avec les doigts juste derrière, les gars, on n’est pas des sauvages non plus), mais je conçois que la série ne puisse pas plaire à tout le monde (on n’est jamais trahi que par ses amis- Ndr). Là, c’est pareil, je pense que les gens accrocheront à fond ou pas, mais qu’il n’y aura pas de milieu.

AmericanGods : Czernobog, ça reste quand même mon petit préféré.
© 2017 Starz Entertainment, LLC / Studio Canal
Source : Poulpe.com
Ces défauts, on peut les détailler vite fait : Shadow Moon a un côté creux, et un charisme qui n’impressionnera que les collégiennes, pour lesquelles cette série n’est pourtant pas conçue a priori. Je ne dis pas qu’il soit mauvais, attention, mais à côté d’un Ian McShane, par exemple, il est tout de suite inconsistant (bon, après, c’est peut-être comme quand on trouvait inconsistant l’acteur de Cyclope, dans les films X-Men : justement, c’est Cyclope) (tapez pas).
C’est parfois aussi vulgaire visuellement qu’Hannibal était élégant. Est-ce dû à la prod Starz, ou est-ce qu’il y a là un message, je me garderais bien de trancher (mon opinion sur le sujet est soumise à variations saisonnières, humeurs, degré d’alcoolémie et qualité du réveil). Le rythme est assez lent, mais c’est en trompe l’œil, il y a pas mal de mises en place, de structures en buildup/payoff plus ou moins discrètes, et d’accélérations violentes, ainsi qu’une structure en puzzle.
La bande son de Brian Reitzell (lui aussi vu, ou plutôt entendu, dans son cas, sur Hannibal) appuie cette notion du puzzle, de cut-up systématique, passant de l’ambiant electro aux cuivres de film noir en passant par du gros son et des percussions atonales quand il s’agit de faire ethnique. L’ensemble a, à chaque fois, un côté cliché, tout en tapant assez juste.
Et peut-être est-ce là la clé de toute l’affaire : les dieux, après tout, sont les clichés ultimes.

Un sourire messieurs dames ?
© 2017 Starz Entertainment, LLC / Studio Canal
Source : EW
—–
Bruce : hé, les gars, y’a cette adaptation tv de American Gods, le fameux bouquin de Gaiman qu’est sortie ! Qui fait la review, hein les gars ?
Les gars : ——–
Bruce : bordel ! c’est pas possible, je me demande à quoi je ne les paie pas ! Heureusement, il me reste (générique de Captain Flam) : NIKOLAVITCH au fond de sa batcave pour nous en parler ! (merci les gars !)
Les gars : ——–
La BO du jour :
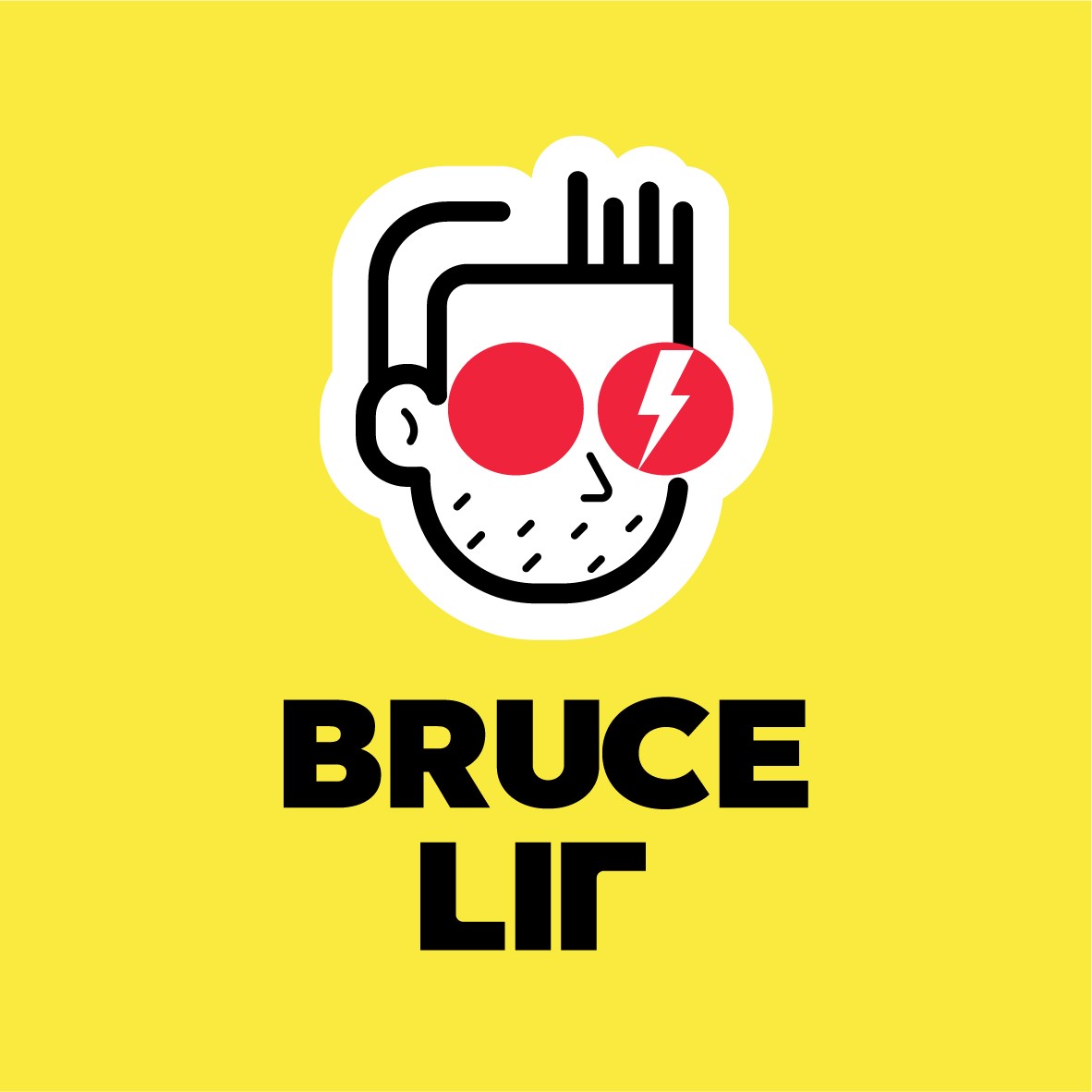

Mauvaise nouvelle : la série est annulée au bout de 3 saisons. Je suis dégoûté.
https://www.premiere.fr/Series/News-Series/Pas-de-saison-4-pour-American-Gods–La-serie-est-annulee
Apparemment Gaiman aurait déclaré qu’il voulait en faire un film ou téléfilm http://www.elbakin.net/fantasy/news/26517-Neil-Gaiman-sur-American-Gods-:-ce-nest-pas-fini
Oui mais rien n’est sûr.